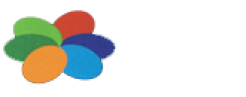| L’actualité de la semaine: |
| Dans une analyse très fouillée, Le Monde s’intéresse cette semaine aux desseins économiques chinois : particulièrement prédateur, l’empire du Milieu met aujourd’hui à mal les industriels européens dans de nombreux domaines, au premier rang desquels l’automobile, mais aussi la chimie. L’hebdomadaire spécialisé Chimie Pharma Hebdo rend compte du colloque qui s’est tenu le 26 mars dernier à la Maison de la Chimie sur le thème des enjeux et des défis posés à la France et à l’Union européenne pour relocaliser leur industrie chimique. Après avoir enregistré des niveaux records de ventes en 2023, le marché de la voiture électrique connaît en ce début d’année 2024 un véritable tassement dont Le Monde nous décrypte les tenants et aboutissants. C’est à l’unanimité que les députés ont adopté le 4 avril la proposition de loi du député écologiste Nicolas Thierry visant à interdire les composants chimiques polyfluoroalkylés et perfluoroalkylés (aussi appelés PFAS) dans différents secteurs à compter du 1er janvier 2026, nous informent Les Echos en insistant sur l’exonération in extremis dont ont bénéficié les ustensiles de cuisine suite à la forte mobilisation du groupe SEB. Enfin, dans les colonnes du Figaro, sont explicitées les velléités du groupe catalan de cosmétiques et de parfums Puig d’entrer en cotation à la Bourse de Madrid. |
| Dans la presse cette semaine |
| DESSEINS ÉCONOMIQUES CHINOIS |
| L’industrie européenne mise à mal par les appétits prédateurs de la Chine Les chiffres sont éloquents : sur la période qui s’est écoulée de 2013 à 2023, le déficit commercial de l’Union européenne face à la Chine s’est littéralement envolé, passant de 104 milliards d’euros en 2013 à 291 milliards d’euros l’année dernière, soit près d’un triplement en valeur. Adam Slater, expert pour le cabinet Oxford Economics, observe : « on constate un vrai découplage commercial entre les Etats-Unis et la Chine. La part des importations chinoises y est passée de 23 % des importations totales en 2018 à 14 % en 2023. Mais on ne voit pas le même phénomène en Europe. » Si l’on prend l’exemple des véhicules électriques chinois, criant dans la mesure où les importations chinoises dans l’Union européenne sont passées de néant à 12 milliards d’euros au cours des cinq dernières années (avec l’avènement de marques telles que BYD et MG) et que le pays est devenu en 2023 le premier exportateur mondial avec 5,2 millions d’unités écoulées en dehors de ses frontières, ceux-ci sont soumis outre-Atlantique à des droits de douane culminant à 27,5% quand ils plafonnent dans l’UE à 10%. Adam Slater analyse ainsi que « la réindustrialisation européenne demeure une aspiration. Pour y arriver, il faut y aller en force. Aucune entreprise n’a envie de modifier son organisation et ses chaînes de valeur, et elles ne le feront que si elles y sont vraiment obligées. » « Les chiffres des exportations de voitures particulières chinoises montrent que nous ne sommes plus dans un monde où la Chine dépasse les autres pays, mais dans un marché mondial où elle domine », décrypte de son côté Anthony Morlet-Lavidalie, économiste pour l’institut d’études Rexecode. Largement subventionnées, les entreprises chinoises peuvent aujourd’hui à ses yeux se targuer d’un « niveau de robotisation des usines beaucoup plus avancé que le nôtre, sans commune mesure ». « Les process technologiques pour la production de voitures électriques sont aussi mieux maîtrisés, sans parler de l’innovation sur les batteries », poursuit-il. L’ultra-dominance de la Chine sur la marché des batteries est tout bonnement saisissante : elle ne contrôle aujourd’hui pas moins de 99% des capacités mondiales de production des batteries dites « LFP » (lithium-fer-phosphate). Dans le domaine des panneaux photovoltaïques, l’empire du Milieu écrase littéralement la concurrence sur l’ensemble de la chaîne de valeurs (silicium, cellules, modules) depuis déjà près d’une décennie. Et ses surcapacités l’amènent à se montrer particulièrement « agressif », ainsi que le qualifie le secrétaire général de l’European Solar Manufacturing Council (ESMC), Johan Lindahl. Dans le domaine de l’éolien, Pierre Tardieu, de l’organisation professionnelle WindEurope, met en garde contre le risque de « livrer aux industriels chinois un marché promis à une forte croissance ». La sidérurgie ou encore le papier sont d’autres secteurs où la concurrence chinoise, plus ou moins directe, s’annonce lourde d’enjeux. Pour ce qui est de la chimie, secteur particulièrement impacté en Europe par les prix de l’énergie, la Chine a vu ses volumes croître l’année dernière de 9,6%, quand ils stagnaient aux États-Unis (-1%) et affichaient en Europe une chute de 8% (après 6,3% en 2022). Directrice générale de France Chimie (ex-Union des industries chimiques), Magali Smets commente : « en cinq ans, la Chine a augmenté ses exportations vers l’Europe de 34 % en chimie organique et de 87 % dans les matières plastiques. Sa part du marché mondial est passée de 20 % en 2008 à plus de 45 %. » Les 500 milliards d’euros que le pays a investis sur la période 2018-2023 dans le « made in China » ont abouti à des « surcapacités, notamment dans la pétrochimie » qui l’amènent à « déverser ses excédents sur l’Europe », explique-t-elle. Faisant état de pratiques commerciales confinant au dumping, la directrice générale de France Chimie tempère néanmoins : « si la Chine est un concurrent féroce, c’est aussi un marché client très important pour les cosmétiques et les parfums français. » Pour compléter le tableau, il convient d’insister sur le rôle incontournable joué par le Chine dans les produits pharmaceutiques. À titre d’exemple, l’empire du Milieu concentre sur son sol pas moins de cinq des sept sites au monde de production du 6-APA, un intermédiaire indispensable à la synthèse de l’amoxicilline, l’antibiotique le plus prescrit au monde, et huit des dix-sept usines qui le fournissent. Pour conclure, rappelons que dans la Chine reste le leader mondial du secteur du textile et de l’habillement, quand bien même cette position dominante est aujourd’hui menacée par le Vietnam, le Bangladesh, le Pakistan ou encore le Cambodge. Analysé par Le Monde |
| RÉINDUSTRIALISATION |
| Un colloque consacré aux « défis de la relocalisation de l’industrie chimique » Le 26 mars dernier était organisé à la Maison de la Chimie, à Paris, un colloque sur le thème des enjeux et des défis posés à la France et à l’Union européenne pour relocaliser leur industrie chimique. Jean-Claude Bernier, professeur émérite à l’université de Strasbourg, a d’emblée établi que « la population ne voulant plus d’usines Seveso dans son voisinage et les procédures réglementaires restant à simplifier », cette réindustrialisation ne se ferait pas sans heurts. Au sujet de l’industrie pharmaceutique, Marie-Christine Belleville, membre de l’Académie nationale de pharmacie, a exposé : « le problème trouve sa racine dans l’explosion de la demande mondiale en médicaments. Avec, dans des pays comme l’Inde, le Pakistan, etc., une croissance démographique qui explose. En Europe, ce phénomène est moindre, mais on observe un vieillissement de la population, accompagné d’une hausse des pathologies chroniques ». Avant de poursuivre : « l’Europe n’est pas en danger en tant que tel, mais il y a beaucoup de besoins par ailleurs. » En ce qui concerne les terres rares, dont il a été rappelé que le Critical Raw Materials Act, publié en ligne en 2023 par la Commission européenne, les classait dans la catégorie des matériaux critiques à « très haut risque », l’extrême dépendance à la Chine, qui assure aujourd’hui 85% de l’approvisionnement mondial, a été mis en exergue. L’occasion d’aborder de façon connexe la problématique de la fin des véhicules thermiques dans l’Union européenne à l’horizon 2035. « À l’avenir, il faudra être capable de produire entre 9 et 12 millions de batteries par an en Europe », a fait valoir Matthieu Hubert, secrétaire général d’Automotive Cells Company (ACC), coentreprise française entre Stellantis, TotalEnergies et Mercedes-Benz. Trois gigafactories, près de Lens (Hauts-de-France), à Kaiserslautern (Allemagne) et à Termoli (Italie), doivent être ouvertes par la joint-venture d’ici 2030. « Elles devraient être capables d’équiper 2,5 millions de batteries par an, soit environ 15 % à 20 % du marché européen », détaille Matthieu Hubert. Enfin, la question des polymères a été abordée par le DG du pôle de compétitivité Polymeris, Patrick Vuillermoz, lequel a insisté sur le fait que « les régions demandent de faire en sorte que de nouvelles usines voient le jour, associées à une dimension de décarbonation. » Rapporté par Chimie Pharma Hebdo |
| INDUSTRIE AUTOMOBILE |
| Le marché des véhicules électriques entre en zone de turbulence Après avoir enregistré des niveaux records de ventes en 2023, le marché de la voiture électrique connaît en ce début d’année 2024 un véritable tassement. Au mois de février, la part de marché des véhicules électriques s’est contractée à 12%, alors qu’elle avait atteint les 14,6% sur l’ensemble de l’année dernière. En Allemagne, les chiffres fournis par l’Agence fédérale pour l’automobile, le 4 avril dernier, font état d’une chute vertigineuse des ventes de véhicules électriques : -29% sur un an en mars, soit une part de marché de 12%, contre 18,4% enregistrés en 2023. En cause notamment, la fin des aides d’État dans un contexte de restrictions budgétaires. La France, où les « wattures » ont constitué 18% des immatriculations au premier trimestre (15,4% sur la même période 2023), fait figure d’exception. Une singularité due à la mise en place de leasing social pour 50 000 véhicules, et à l’anticipation du coup de rabot sur le bonus écologique, passé de 5000 à 4000 euros mi-février. Eric Champarnaud, directeur général du cabinet C-Ways, analyse : « cet ajustement à la baisse, mais aussi l’essoufflement de la croissance des revenus des ménages, a pour effet d’augmenter le taux d’effort des acheteurs. Le coup de frein qui se dessine intervient alors que les constructeurs, après avoir répondu à la demande d’acheteurs convaincus par la voiture électrique, doivent trouver un second souffle auprès d’une nouvelle clientèle, moins enthousiaste et plus sensible au prix. Une autre entrave au développement des véhicules électriques se trouve dans le manque d’enthousiasme dont font preuve les entreprises pour verdir leurs flottes. Les véhicules électriques ne représentent que 11% de leurs immatriculations alors qu’elles sont les principales pourvoyeuses de véhicules d’occasion récents. Le député Damien Adam a en ce sens déposé une proposition de loi visant à sanctionner les entreprises ne se soumettant pas aux quotas d’électrification définis dans la loi d’orientation des mobilités. Consultant associé chez Inovev, Jamel Taganza prédit en Europe « une croissance ralentie sur une période de trois à quatre ans ». Il affirme : « la période de transition qui s’ouvre s’annonce compliquée. Tant que l’on n’aura pas levé la barrière du prix, les ventes de modèles électriques vont progresser à plus faible allure. » C’est tout l’objet des modèles bon marché qui doivent être lancés prochainement : Citroën ë-C3, Renault R5 et nouvelle Twingo, ou encore les prochaines Volkswagen et Fiat. Mais dans cette bataille de l’accessibilité des prix, les constructeurs chinois devraient aussi tirer leur épingle du jeu. Inovev prévoit ainsi qu’à l’horizon 2030, les constructeurs de l’empire du Milieu, BYD en tête, devraient fournir jusqu’à un cinquième du marché des véhicules électriques en Europe. Jamel Taganza alerte : « face à l’arrivée de ces voitures accessibles et technologiquement évoluées, s’en remettre à la taxation des importations ne sera pas suffisant. » Décrypté par Le Monde |
| PFAS |
| L’interdiction des « polluants éternels » adoptée à l’unanimité par les députés, qui exonèrent toutefois les ustensiles de cuisine C’est par 186 voix pour et 0 contre, pour 213 députés présents, que l’Assemblée nationale a adopté le 4 avril dernier la proposition de loi du député écologiste Nicolas Thierry visant à interdire les composants chimiques polyfluoroalkylés et perfluoroalkylés (aussi appelés PFAS) dans différents secteurs à compter du 1er janvier 2026, à savoir les cosmétiques, les produits de fart pour les skis et la plupart des textiles d’habillement. « C’est un premier jalon important dans la lutte contre les polluants éternels, nous avons aujourd’hui envoyé un message fort », c’est targué Niclas Thierry à l’issue du vote. Sous la pression du groupe SEB, au nom notamment des 3000 emplois sur le territoire national qui auraient été menacés, les ustensiles de cuisine avaient été exclus du texte. Représenté au Palais Bourbon par son ministre de l’Industrie, Roland Lescure, le gouvernement avait pourtant manifesté son opposition au texte dans la mesure où « la pollution aux PFAS est certes un enjeu de santé publique, mais la régulation doit se faire au niveau européen », avait justifié le ministre. Au sujet du PTFE, la molécule usitée dans les poêles SEB, Roland Lescure a estimé qu’il « sera très vraisemblablement jugé non dangereux au niveau européen », confessant néanmoins que « nous n’avons pas assez de données » pour le certifier. Prévoyant l’interdiction progressive des rejets aqueux de PFAS dans les cinq ans suivant la promulgation de la loi, le contrôle obligatoire de leur présence dans l’eau potable, ainsi que l’application du principe du « pollueur payeur » pour les industriels, le texte voté par les députés a été salué comme « une première belle victoire » par l’ONG Générations futures. Le texte doit maintenant être voté par les sénateurs, éventuellement à la faveur de la niche parlementaire écologiste du 30 mai prochain. Couvert par Les Echos |
| PUIG |
| Le groupe espagnol de cosmétiques Puig entre à la Bourse de Madrid « C’est une étape décisive dans les 110 ans d’histoire de Puig qui nous permettra d’être plus compétitifs sur le marché international de la beauté au cours de la prochaine phase de développement de l’entreprise » : tels sont les propos tenus le 8 avril dernier par Marc Puig, petit-fils du fondateur et PDG du groupe catalan de cosmétiques, lors de l’annonce de sa volonté de lever 1,25 milliard d’euros à la Bourse de Madrid. En parallèle, la holding de la famille Puig, Exea, devrait vendre une partie de ses actions du groupe. Ce qui pourrait valoriser l’entreprise dans une fourchette comprise entre 8 et 10 milliards d’euros, tablent les analystes. Puig adopterait ainsi un modèle de groupe à la fois coté en bourse et adossé à un premier actionnaire familial puissant, comme c’est le cas pour L’Oréal, Estée Lauder, ou encore LVMH. Des « résultats records » ont été enregistrés par Puig en 2023 : 4,3 milliards d’euros de chiffre d’affaires (+19% sur un an), 849 millions d’Ebitda (+33%). 72% de ses ventes proviennent aujourd’hui des parfums, notamment grâce à son acquisition de la société Jean Paul Gaultier en 2011. Après avoir pris en 2020 le contrôle de la marque britannique de soins et maquillage de luxe Charlotte Tilbury Beauty, Puig s’est étoffé cette année en janvier des produits de soin allemands Dr Barbara Sturm. La décision d’entrer en cotation aujourd’hui a probablement vocation à rassurer les investisseurs. Dans un entretien accordé l’année dernière à Vogue Business, Marc Puig déclarait : « à mesure que les entreprises se développent, la capacité à trouver le bon leadership parmi un petit groupe de personnes versus le monde ou auprès des 10.000 personnes qui travaillent dans notre entreprise devient de plus en plus improbable. Nous avons choisi de trouver ces talents de leadership à l’extérieur. Le rôle de la famille est de conserver le système de valeurs que nous souhaitons dans la gestion de l’entreprise. » Source : Le Figaro |