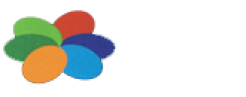| L’actualité de la semaine: |
|
| L’immixtion dans une fonderie d’aluminium de Basse-Saxe caractéristique du Mittelstand allemand confère cette semaine l’occasion au Monde d’analyser les difficultés auxquelles font aujourd’hui face outre-Rhin les entreprises de taille petite à intermédiaire. Dans les colonnes des Echos, on découvre le scepticisme qui commence à poindre chez les constructeurs automobiles quant à l’interdiction des véhicules à motorisation thermique dans l’UE à l’horizon 2035. Toujours dans le quotidien économique de référence, la lumière est faite sur les ambitions contrariées des industriels tricolores dans leur trajectoire de décarbonation. Les politiques d’adaptation mises en place au sein de l’UE « ne sont pas assez réactives face à l’accroissement rapide des risques » climatiques : tel est le constat dressé par l’Agence européenne pour l’environnement (AEE) dans un rapport rendu public le 11 mars dernier dont Libération se fait l’écho. Enfin, dans Le Figaro, on apprend qu’en dépit de la situation particulièrement difficile que connaît aujourd’hui son groupe, le PDG de Bayer, Bill Anderson, n’envisage pour l’heure ni la scission de ses branches santé et agro-industrielle, ni la cession de la branche santé grand public. |
| Dans la presse cette semaine |
| MITTELSTAND |
| Outre-Rhin, la perte de compétitivité met à mal le tissu industriel des PME Naguère pilier de l’économie allemande, le terme de « Mittelstand » désigne l’ensemble des entreprises de taille petite à intermédiaire du pays. Si l’Union européenne caractérise les petites et moyennes entreprises (PME) par un chiffre d’affaires annuel sous la barre des 50 millions d’euros et un plafond de 250 salariés, une spécificité culturelle de l’Allemagne est d’inclure dans le Mittelstand desentreprises familiales parfois bien plus importantes. Datant de 2021, les dernières données de l’Institut de recherche pour le Mittelstand font état d’un chiffre d’affaires annuel des PME allemandes s’établissant à 2400 milliards d’euros, soit 31% du total des entreprises nationales, et d’une contribution de l’ordre de 61% à leur valeur ajoutée nette totale. Pas moins de 19 millions de personnes sont employées par ce Mittelstand, c’est-à-dire 54% de l’emploi salarié allemand, et sept apprentis sur dix. Or, la conjoncture s’avère pour le moins difficile : le site spécialisé d’information Creditform révèle ainsi qu’en 2023, le nombre de faillite d’entreprises a cru de 23%par rapport à 2022, la progression se chiffrant même à 30% dans l’industrie. Et le contexte ne prête guère à l’optimisme quant à un retournement de la situation : fin février, alors que le gouvernement révisait ses prévisions de croissance pour 2024d’1,3% à 0,2%, le ministre de l’économie, Robert Habeck, faisait le diagnostic d’une situation « dramatiquement mauvaise ». Les annonces de restructurations drastiques s’enchaînent chez les grands équipementiers automobiles, donneurs d’ordre historiques des PME : 3000 suppressions de postes viennent ainsi d’être officialisées chez Bosch, 7000 chez Continental, tandis que ZF vient d’engager unplan d’économies de quelque 6 milliards d’euros… Jonas Eckart, spécialiste des restructurations d’entreprise chez Falkenberg, observe : « pour les petits sous-traitants automobiles, c’est le début de la fin. Ceux qui se trouvent sous la barre des 100 millions de chiffre d’affaires et sont spécialisés dans le moteur thermique sont directement menacés par la fin annoncée de cette technologie en 2035. Il y a évidemment toujours des possibilités d’utiliser son savoir-faire et sa technique pour développer d’autres produits. Mais quand on n’a pas la taille critique, il est très difficile de réussir sa transition. » Tel est le contexte difficile auquel fait aujourd’hui face lafonderie Roeders, sise à Soltau, en Basse-Saxe, avec ses 500 salariés pour unchiffre d’affaires de 60 millions d’euros. Son PDG, Gerd Roeders, relate : « l’hiver dernier, la situation est devenue extrêmement critique, avec l’explosion des prix de l’énergie et l’effondrement des commandes automobiles. Alors nous sommes allés voir les constructeurs, pour exiger une augmentation des prix d’achat de nos pièces. Nous avons joué dur, nous les avons menacés de non-livraison et de faillite, en tablant sur le fait qu’ils n’auraient pas le temps de se tourner vers la concurrence. Et nous avons obtenu gain de cause. » Si l’entreprise est parvenue jusqu’ici à ne pas déposer le bilan, le dirigeant l’explique en ces termes : « une fonderie normale a deux alliages. Nous en proposons douze, pour tout type d’usage spécial du métal. Un constructeur ne retrouve pas cela facilement sur le marché. » Ce qui ne l’empêche pas de pousser ce cri d’alarme : « mais combien de temps allons-nous pouvoir tenir avec ces prix structurellement élevés en Allemagne et le manque de main-d’œuvre ? Notre site de production en République tchèque produit déjà dix fois plus d’aluminium qu’ici. Il faut qu’il se passe quelque chose en Allemagne, et vite. C’est tout notre modèle qui est menacé. » Avec des dépenses sociales croissantes du fait d’une population vieillissante, les entreprises allemandes connaissent aujourd’hui un taux d’imposition de 29,9%, soit bien davantage qu’aux États-Unis ou même qu’en France. À ceci s’ajoute une lourdeur bureaucratique qui entraverait l’innovation : « toute cette administration, ça tue notre motivation ! On a l’impression que certains politiques imposent des technologies sans aucune idée des conséquences, sans confiance dans la capacité d’innover », s’insurge Olgierd Lemanski, ingénieur d’origine polonaise, chef de la production chez Roeders. En guise de conclusion, Gerd Roeders pose le problème du Mittelstand en ces termes : « la seule question est de savoir si l’Allemagne et l’Europe sont prêtes à défendre leur industrie et des entreprises comme celle-ci, et ce qu’elles représentent pour le pays. » Analysé par Le Monde |
| MARCHÉ AUTOMOBILE |
| Les dirigeants du secteur automobile remettent en question l’interdiction des véhicules thermiques dans l’UE à l’horizon 2035 Les velléités des constructeurs automobiles à opérer avant 2035 une conversion au tout-électrique ont du plomb dans l’aile. Au point que se pose désormais avec acuité la perspective d’un report de l’échéance de 2035 pour le bannissement de la commercialisation de véhicules thermiques dans l’Union européenne. Dans la perspective des élections européennes du mois de juin, le PDG de Stellantis, Carlos Tavares, a ainsi dégagé deux scénarios : dans le premier, en cas de victoires des « progressistes dogmatiques », « une accélération des voitures électriques », et dans le second, si les « populistes » venaient à l’emporter, « un ralentissement ». Dans un entretien accordé à l’agence Bloomberg fin janvier, Lutz Meschke, le directeur financier de Porsche, avançait quant à lui : « il y a beaucoup de discussions en ce moment autour de la fin du moteur à combustion. Je pense que cela pourrait être retardé. » À l’occasion du Salon automobile de Genève qui s’est tenu fin février, le patron de Renault, Luca de Meo, qui préside par ailleurs actuellement le lobby des constructeurs européens, l’Acea, s’est montré ambigu. S’il a lors d’une conférence de presse mis en avant l’irréversibilité de l’échéance de 2035, il a le lendemain tenu ces propos : « à la base, nous demandions une date postérieure parce que nous pensions que le délai serait trop court. C’est entre les mains du législateur […] j’espère que l’interdiction s’appliquera un peu plus tard, parce que nous ne serons pas capablesde le faire sans endommager toute l’industrie. » Alors qu’en 2022, Renault s’engageait à être tout électrique en Europe dès 2030, le directeur général, Fabrice Cambolive, se félicite aujourd’hui que le groupe marche sur ses « deux jambes » électrique et thermique. Un modèle qui a ses yeux pourrait continuer « pour les dix années à venir ». Thomas Besson, analyste chez Kepler Cheuvreux, analyse : « Avec la fin du projet de mise en Bourse d’Ampere , son entité consacrée à l’électrique,Renault est en train de rééquilibrer son discours. D’autres constructeurs font de même. Et certains ‘désinvestissent’ en repoussant des investissements ou des lancements dans l’électrique, contribuant à la hausse de leurs cours de Bourse, augmentant le potentiel de retour de cash aux actionnaires et améliorant la perception du risque électrique. » Une des explications du changement de pied des constructeurs se situe dans l’arrêt brutal des subventions à l’achat d’un véhicule électrique décidé fin 2023 en Allemagne. Uwe Hochgeschurtz, patron Europe de Stellantis, justifie : « les Etats devraient davantage assumer leurs responsabilités. Ils ont pris des engagements internationaux de baisse de leurs émissions de CO2 et les aides sont nécessaires pour décarboner la mobilité en augmentant les ventes. »Subventionner ou reporter les objectifs d’électrification du parc automobile européen : tel serait aujourd’hui le dilemme auquel doivent répondre les dirigeants européens. Alors qu’un report permettrait aux constructeurs de gonfler à court terme leurs marges, il aurait pour conséquence d’aggraver le retard dont pâtissent déjà les Européens face à leurs homologues chinois. Décrypté par Les Echos |
| TRANSITION ÉCOLOGIQUE |
| Les ambitions contrariées des industriels tricolores dans leur trajectoire de décarbonation Troisième secteur le plus émetteur de CO² derrière le transport et l’agriculture, l’industrie hexagonale fait aujourd’hui face à des vents contraires dans sa trajectoire de décarbonation. Alors que le gouvernement vient de procéder à un coup de rabotsur le bonus écologique à l’achat d’un véhicule électrique, un acteur du marché des biens d’équipement pour l’automobile dresse ce constat : « depuis le début de l’année, on ressent une défiance face à la transition à mener : on n’a pas pris une commande de constructeur européen dans le cadre de projets d’e-mobilité ou de véhicule hybride. » En décembre dernier, le gouvernement validait pourtant avec les cinquante sites hexagonaux les plus émetteurs de CO² des feuilles de route visant une réduction de 45% de leurs émissions carbonées à l’horizon 2030, avec pas moins de cinq milliards d’euros alloués pour les accompagner. Si aucun de ces industriels ne remet aujourd’hui en question l’impératif de décarbonation, la conjoncture se révèle particulièrement défavorable, entre hausse des matières premières, de l’énergie, etraréfaction de la main d’œuvre. Des phénomènes conjugués qui donnent lieu à uneinflation à la fois des investissements nécessaires (capex) et des coûts de fonctionnement (opex). Le dirigeant d’un grand groupe chimique français, qualifiant ladécarbonation de « chemin de croix », constate : « nos usines tournent à moins de 70 % de leurs capacités, ce qui réduit sensiblement nos capacités d’investissement alors même que le coût de nos capex a augmenté de 20 % à 50 % sur nos projets de décarbonation, et ceux de nos opex jusqu’à 30 %. » Il poursuit : « nous ne pourrons tenir notre feuille de route. A moins de mettre à jour les montants d’aides publiques initiales qui couvrent 30 % à 50 % de l’investissement, il va falloir décaler de plusieurs années certains projets de décarbonation. » À l’instar de Laurent Courtois, directeur énergie climat d’Aluminium Dunkerque, les industriels réclament notammentdavantage de visibilité sur les coûts de l’électricité. Ou encore sur ceux du carbone. Il faut dire que le prix des quotas de CO2 dans le cadre du système d’échange européen a diminué de moitié en un an, passant de 95 euros en février 2023 à 52,5 euros ces dernières semaines. « Toutes les données sur lesquelles sont fondés nos plans de décarbonation sont très volatiles, cela exige de la flexibilité et un esprit partenarial », observe un fournisseur de matériaux classé parmi les 50 sites hexagonaux les plus émetteurs. Un expert du ministère de l’Industrie tente néanmoins de rassurer : « nous sommes sur une décarbonation profonde et non pas incrémentale, l’objectif est d’avoir l’usage le plus efficace de l’argent public, soit 30 à 40 euros par tonne de CO2 supprimée, contre 300 à 600 euros par tonne pour la rénovation thermique. » Du côté de l’Ademe, on fait valoir que les sommes dégagées sont pérennes, et on invite les industriels à prendre le temps de la réflexion dans leur projet de décarbonation. Au risque d’être pris au dépourvu àl’international dans la lutte concurrentielle à la réduction des émissions. Relayé par Les Echos |
| POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE |
Urgence climatique : l’Agence européenne pour l’environnement appelle l’Europe à améliorer ses politiques d’adaptation Dans un rapport publié le 11 mars, l’Agence européenne pour l’environnement (AEE) souligne que les politiques d’adaptation mises en place au sein de l’UE « ne sont pas assez réactives face à l’accroissement rapide des risques » climatiques, bien que le Vieux Continent soit celui « qui se réchauffe le plus rapidement au monde ». Concrètement, l’AEE a détaillé 36 risques climatiques majeurs pour l’Europe, classés par niveau de gravité à court, moyen et long termes, dont le stress thermique pour la population et la dégradation des écosystèmes côtiers et marins.22 de ces risques pourraient atteindre « un seuil critique, voir maximal » d’ici 2050, tandis que plus de la moitié d’entre eux deviendraient « catastrophiques » d’ici la fin de ce siècle faute d’actions significatives. Huit risques exigent des mesures immédiates : l’altération des écosystèmes liée à la mortalité forestière, celle de lasanté des sols, l’augmentation des espèces exotiques envahissantes et lespullulations d’insectes. La réduction de la pollution agricole et industrielle fait également partie des chantiers prioritaires, selon l’AEE. Compte tenu de la situation, l’agence exhorte donc les Etats à se baser sur les scénarios les plus extrêmes pour élaborer leurs politiques environnementales, au lieu de continuer à utiliser les scénarios moyens. L’AEE propose aussi des pistes pour améliorer l’adaptation au changement climatique, tout en préservant la justice sociale. Parmi elles figurent une transition des protéines d’origine animale vers celles d’origine végétale pour limiter les dégâts dans le secteur agricole, l’adoption de solutions de refroidissement moins énergivores dans les bâtiments et une « forte augmentation des ressources du Fonds de solidarité » de l’UE pour « encourager des mesures d’adaptation plus importantes au niveau national ». A la suite du rapport de l’AEE, la Commission européenne compte appeler les Etats membres à l’action le 14 mars, mais aucune proposition législative ne sera présentée car les élections européennes approchent.
Paru dans Libération |
| BAYER |
Malgré la crise, le groupe Bayer n’envisage pas une scission Alors que le groupe Bayer traverse une crise profonde depuis son rachat de Monsanto en 2018, avec des pertes s’élevant à 2,9 milliards d’euros en 2023, sonPDG, Bill Anderson, a déclaré que ni la scission de ses branches santé et agro-industrielle ni la cession de la branche santé grand public ne seraient les solutions les plus adaptées aux difficultés du géant allemand. Le dirigeant a néanmoins reconnu qu’« une structure de pure player est devenue la norme dans l’industrie », comme en témoignent Sanofi, Novartis et Johnson & Johnson, qui ont cédé leurs activités de santé grand public. D’après Bill Anderson, Bayer fait face à quatre défis de taille. Tout d’abord, l’entreprise souffre de la perte progressive de brevets sur ses médicaments à succès, dont l’anticoagulant Xarelto. Ensuite, elle perd en efficacité en raison de sa « bureaucratie excessive » et de l’« empilement progressif » des divisions. Enfin, les deux autres problèmes majeurs de Bayer sont liés à l’acquisition de Monsanto. Il s’agit des nombreuses plaintes contre le PCB et le glyphosate, accusé de provoquer les cancers, ainsi que de la dette « colossale » du groupe allemand, qui a atteint 34,5 milliards de dollars en 2023. Bill Anderson a déjà annoncé des mesures pour relancer Bayer. En premier lieu, il a dévoilé un plan d’économies de 2 milliards d’euros par an à partir de 2026, qui entraînera notamment des suppressions d’emplois chez les cadres. En deuxième lieu, il a proposé une réduction de 95% des dividendes jusqu’en 2025 pour favoriser le désendettement.
Rapporté par Le Figaro |