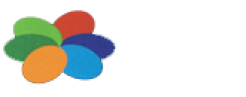| L’actualité de la semaine: |
| Cette semaine, Les Echos soulignent que les chimistes européens font face à une demande en berne, qui s’ajoute aux difficultés liées à la hausse des prix de l’énergie. Le quotidien économique nous apprend également qu’en France, l’ensemble de l’industrie manufacturière, y compris la chimie, est confrontée à un ralentissement de la production. Un rebond serait toutefois possible avec des investissements massifs dans la décarbonation et l’automatisation. La lutte contre le réchauffement climatique continue d’ailleurs d’être au cœur des débats. Le 6 février, la Commission européenne a annoncé vouloir réduire de 90% ses émissions de gaz à effet de serre, et cela malgré la contestation croissante de ses politiques environnementale, notent Les Echos. Et d’ajouter qu’en France, l’Etat s’est engagé à garantir jusqu’à 2 milliards d’euros de prêts verts aux entreprises pour favoriser leur adaptation aux changements climatiques. Enfin, le 7 février, les eurodéputés ont voté un texte sur les nouveaux OGM plus contraignant que celui proposé par la Commission européenne, rapporte Le Monde. |
| Dans la presse cette semaine |
| CHIMIE |
| L’industrie chimique confrontée à une demande en berne L’industrie chimique européenne est actuellement confrontée à une demande en berne, un phénomène qui aggrave les difficultés liées à la flambée des prix de l’énergie. Dans ce contexte, le taux d’utilisation des capacités de production est tombé à son plus bas niveau depuis dix ans en Europe, avec une moyenne de 74,1%, nettement inférieure aux 80% nécessaires pour atteindre l’équilibre. En Allemagne, les prix élevés de l’énergie et des matières premières ont même entraîné la fermeture temporaire de certains sites de production. Cette crise de la demande tient en grande partie à la stratégie adoptée par les clients du secteur chimique, ces derniers préférant écouler les stocks dont ils disposent plutôt que miser sur une croissance qu’ils jugent incertaine. La situation est comparativement meilleure en France, mais le recul de la production du secteur chimique n’en atteint pas moins 3,9% sur les neuf premiers mois de l’année 2023 (contre 10,6% dans le reste de l’Union européenne). Compte tenu de la situation, les observateurs craignent une perte de compétitivité irrémédiable. « Les prix de l’énergie sont un tapis rouge déroulé à nos concurrents asiatiques et américains. Si nous ne réagissons pas, nous allons vers une désindustrialisation à petit feu », affirmait récemment Frédéric Gauchet, président de France Chimie. Les perspectives d’amélioration sont par ailleurs peu réjouissantes, une reprise de la demande n’étant pas attendue avant le deuxième semestre 2024. « Les prix élevés de l’énergie et des matières premières, ainsi que le manque de commandes, vont continuer de peser sur notre activité. En conséquence, nos entreprises sont obligées de couper dans leurs coûts, soit en fermant des usines de production, en abandonnant certains segments, ou en déplaçant leurs investissements à l’étranger », s’inquiétait récemment Markus Steilemann, le patron de l’organisation VCI, qui regroupe les chimistes allemands. Analysé par Les Echos |
| INDUSTRIE FRANÇAISE |
| Les usines françaises font face à un ralentissement de la production Les usines françaises subissent un ralentissement de leurs activités. Dans l’automobile, elles tournent à 55% de leurs capacités, tout comme dans l’agroalimentaire. Les acteurs en amont de la chaîne de valeur, y compris la chimie, affichent des niveaux de production « historiquement bas », avec un taux d’utilisation de 60% à 70% du nominal. En revanche, d’autres secteurs, dont le luxe, l’aéronautique et la défense, semblent tirer leur épingle du jeu. Grâce à cette situation « très contrastée », le taux d’utilisation global des capacités de l’industrie manufacturière française s’est maintenu à 80,7% en décembre d’après l’Insee, contre 82,1% en moyenne depuis 1995. Toutefois, Trendeo a enregistré un bond de 46 % de fermetures d’usines en 2023, tandis que les annonces d’ouvertures ont baissé de 12 %. Qui plus est, le baromètre d’Adecco a révélé que le nombre d’offres d’emploi dans l’industrie a baissé de 10% au cours du dernier trimestre et de 21% sur un an. Plusieurs raisons expliquent ce retournement de tendance, dont la hausse des prix de l’énergie et de la tonne de CO2, les conséquences de l’inflation et la chute de la demande intérieure chinoise, qui encourage Pékin à exporter ses produits en Europe au détriment des industriels locaux. Le rebond « dépendra de l’évolution des prix de l’énergie, de celui des conditions de financement mais aussi de notre capacité à être compétitifs et attractifs par rapport à nos concurrents européens comme non européens », explique Olivier Redoules, directeur des études de Rexecode. Ce regain de compétitivité exige notamment un investissement « massif » dans les nouveaux marchés de la décarbonation et de l’automatisation. « C’est un sprint qu’il faut opérer maintenant pour pouvoir s’imposer », insiste Anne-Sophie Alsif, cheffe économiste de BDO. C’est pourquoi la baisse des investissements manufacturiers est alarmante : d’après l’Insee, ils ont reculé de 1,7% au dernier trimestre 2023 et cette baisse devrait continuer en 2024. Publié dans Les Echos |
| ENVIRONNEMENT |
| L’UE annonce vouloir réduire de 90% ses émissions de gaz à effet de serre d’ici 2040 Alors que les agriculteurs et les industriels critiquent les politiques environnementales menées par la Commission européenne, Bruxelles a annoncé, le 6 février, un objectif climatique ambitieux : la réduction de 90% des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2040, par rapport au niveau de 1990. D’après la Commission, il s’agit de la seule manière de garantir la neutralité carbone d’ici 2050, comme prévu dans le Pacte vert. Cette annonce n’est que la première étape d’un long processus, car les moyens d’atteindre ce résultat seront détaillés dans une loi qui sera définie après les élections européennes de juin. Avec cette feuille de route, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, prend d’ailleurs le risque de donner des arguments aux partis moins soucieux de l’environnement ou de déplaire aux électeurs. La nouvelle cible 2040 concerne tous les secteurs de l’économie et prévoit, entre autres, la décarbonation complète du secteur de l’énergie, l’élimination des combustibles fossiles, le renforcement du captage et du stockage du carbone, une exploitation accrue de l’énergie atomique et l’instauration d’une tarification du carbone. Les financements nécessaires pour mettre en place ces mesures sont toutefois conséquents : l’UE chiffre à environ 660 milliards d’euros par an entre 2031 et 2050 l’investissement annuel dans le système énergétique (hors transports). En incluant les transports, il faudrait rajouter environ 870 milliards par an. Reste à savoir comment trouver ces sommes. Toutefois, « l’inaction entraînerait des coûts bien plus importants et croissants dans les décennies à venir », a rappelé Wopke Hoekstra, commissaire européen à l’Action pour le climat. Les pistes envisagées pour financer ces changements incluent une contribution des Etats membres et de nouveaux emprunts qui seraient contractés par la prochaine Commission. Paru dans Les Echos |
| RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE |
| L’Etat garantira jusqu’à 2 milliards d’euros de prêts verts pour les entreprises Le 8 février, Bruno Le Maire et Christophe Béchu, respectivement ministre de l’Economie et ministre de la Transition écologique, ont annoncé que l’État garantirait jusqu’à 2 milliards d’euros de prêts verts pour les entreprises souhaitant adapter leur outil de production aux conséquences du réchauffement climatique. Distribués par Bpifrance, ces prêts pourront atteindre 2 millions d’euros par entreprise, voire 2,5 millions pour celles du secteur industriel. Les sommes octroyées pourront être utilisées pour financer des projets aussi divers que l’isolation des bâtiments, l’installation de systèmes de récupération d’eau ou de filtration des eaux usées, ou encore la mise en place de systèmes de prévention des incendies autour des entrepôts. A travers cette mesure, le gouvernement entend encourager les entreprises à développer des plans d’adaptation spécifiques à leur secteur et à leur activité. Le ministre de l’Économie a par ailleurs tenu à préciser que tout investissement public ne tenant pas compte de l’adaptation au changement climatique serait dorénavant refusé. Pour rappel, en septembre 2022, le think tank I4CE avait évalué à 50 milliards d’euros par an le montant des investissements publics prenant pas en considération le changement climatique. « Concevoir des infrastructures de transports qui ne résisteront pas à de futurs événements météorologiques fragilise les chaînes logistiques essentielles pour l’économie. Soutenir le développement de filières agricoles ou touristiques sans s’assurer de leur adaptation revient à préparer les crises sociales de demain – quand faute d’eau ou de neige des pans entiers de l’économie seront sinistrés », mettaient alors en garde auteurs de l’étude. Rapporté par Les Echos |
| AGRICULTURE |
| Les eurodéputés en faveur de règles plus strictes sur les nouveaux OGM Le 7 février, le Parlement européen a voté un texte sur les « nouveaux OGM » plus strict que celui proposé par la Commission européenne, et même plus contraignant que celui adopté en commission de l’environnement (ENVI). Le même jour, les Etats membres n’ont pas trouvé d’accord sur un texte en la matière, ce qui rend « improbable » la finalisation de ce projet au cours de cette mandature. Concrètement, les eurodéputés ont choisi d’exempter d’évaluation des risques les plantes issues de nouvelles techniques génomiques ayant subi au maximum vingt modifications (NGT-1), pourvu qu’elles favorisent la durabilité de l’agriculture, par exemple en améliorant la résistance à des maladies ou l’adaptation au réchauffement climatique. Par contre, les variétés NGT qui seraient rendues tolérantes à des herbicides ne pourraient pas bénéficier de cet assouplissement. Le texte voté par les eurodéputés impose également la traçabilité et l’étiquetage de ces nouvelles variétés jusqu’au produit final. Parmi les autres mesures approuvées figurent la non-brevetabilité des NGT, l’obligation de surveillance environnementale et la possibilité d’arrêter la commercialisation d’une plante NGT si les autorités nationales identifient un risque. Selon Christophe Clergeau, rapporteur du texte pour le groupe social-démocrate, « la crainte d’une déstabilisation de la petite agriculture paysanne est l’une des raisons des surprises de ce vote. Les élus de certains pays d’Europe orientale ont préféré adopter une posture de prudence indépendamment de leur couleur politique. » De leur côté, la plupart des ONG de l’environnement critiquent le texte. « Sans dispositif limitant la contamination, ni obligation de publier les méthodes de détection et d’identification, ce règlement fragiliserait l’existence d’alternatives agricoles sans OGM, respectueuses de la biodiversité et de l’environnement », estime l’association Pollinis. Relaté par Le Monde |