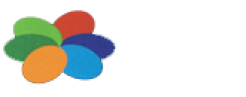| L’actualité de la semaine: |
| Le 11 avril dernier, ExxonMobil annonçait l’arrêt définitif de son vapocraqueur de Gravenchon, en Seine-Maritime. C’est l’occasion pour l’hebdomadaire Le Marin de lever le voile sur les faiblesses structurelles d’une pétrochimie européenne en proie à une grave perte de compétitivité. Alors que le chancelier Olaf Scholz entame une visite diplomatique en Chine, Le Monde analyse les divergences d’intérêts entre les grands groupes allemands, qui investissent massivement dans l’empire du Milieu, et le tissu industriel des PME d’outre-Rhin, pour lesquelles la présence sur le marché chinois n’est plus aussi favorable aujourd’hui. Ce voyage officiel d’Olaf Scholz à Pékin a constitué pour le géant automobile Volkswagen le moment opportun d’annoncer son intention d’investir pas moins de 2,5 milliards d’euros dans son centre de Hefei, en Chine orientale, pour accroître sa force d’innovation locale, nous rapportent Les Echos. Toujours dans le quotidien économique de référence, il est question des amendements apportés par les députés de la commission du Développement durable à la proposition de loi sur le verdissement des flottes d’entreprises. Dans les colonnes du Monde, un reportage est consacré à l’Avenza, cet herbicide qui sème la discorde au sein de la filière rizicole camarguaise. Enfin, dans La Croix, sont exposées les motivations de la Cour européenne des droits de l’homme dans son arrêt condamnant, le 9 avril dernier, la Suisse pour « inaction climatique » |
| Dans la presse cette semaine |
| PÉTROCHIMIE EUROPÉENNE |
| ExxonMobil annonce l’arrêt définitif de son vapocraqueur de Gravenchon, près du Havre « Il est très difficile de savoir à quel horizon d’autres restructurations auront lieu en Europe. Mais il est certain que la perte de compétitivité de la pétrochimie européenne est structurelle » : c’est en ces termes que Jean-Yves Daclin, directeur de l’association des producteurs de résine plastique Plastics Europe France, laquelle compte parmi ses membres ExxonMobil, TotalEnergies ou encore BASF, a commenté l’annonce, le 11 avril dernier, de l’arrêt définitif par ExxonMobil de son vapocraqueur de Gravenchon, en Seine-Maritime. Cette fermeture s’explique pour partie par la faible capacité du site : « environ 400 000 tonnes par an » quand « les nouveaux vapocraqueurs qui se construisent, par exemple au Moyen-Orient ou aux États-Unis, font souvent plus de 1 million de tonnes par an », précise Jean-Yves Daclin. Autre facteur explicatif de la baisse de compétitivité des vapocraqueurs européens : ceux-ci fonctionnent le plus souvent avec du naphta (soit une coupe pétrolière), à l’heure où la révolution des gaz de schistes outre-Atlantique a permis l’essor d’une production d’éthane très bon marché. La concurrence de la Chine, laquelle se trouve aujourd’hui en surcapacités de production et inonde le marché européen de polyéthylène et autres polymères à des prix défiant toute concurrence, constitue une autre entrave à la compétitivité européenne. Jean-Yves Daclin se fait le chantre d’une réflexion sur « la manière de protéger l’industrie européenne ». Plastics Europe France plaide notamment pour un « Inflation Reduction Act » sur le modèle de celui mis en œuvre par l’administration Biden aux États-Unis, ou encore une taxe carbone aux frontières. Au-delà de la défense d’une industrie locale, c’est la possibilité d’une offre de proximité propice au développement de produits qui est en jeu. « C’est aussi une question d’indépendance et de souveraineté, à mettre en parallèle avec la volonté de réindustrialisation affichée par la France », scande le directeur de Plastics Europe France. Couvert par Le Marin |
| ÉCONOMIE ALLEMANDE |
| Relations germano-chinoises : les grandes entreprises et les PME allemandes divisées par des intérêts divergents Alors que le chancelier Olaf Scholz vient d’entamer sa visite en Chine accompagné par des représentants de grands groupes allemands, les relations entre les deux pays « ont fondamentalement changé » par rapport à la décennie 2010. Selon Noah Barkin, analyste pour l’institut de recherche Rodium Group, elles auraient même atteint « un point de bascule », puisque les « investissements allemands en Chine correspondent à un désinvestissement en Allemagne ». A ce propos, les grands groupes d’outre-Rhin, qui augmentent leur production en Chine, et les entreprises de taille moyenne, pour qui la présence sur le marché chinois n’est plus aussi favorable, affichent désormais des intérêts divergents. Concrètement, « beaucoup de PME redoutent de perdre la technologie sur laquelle ils sont à la pointe mondiale, s’ils produisent en Chine, et préfèrent y exporter. Mais l’accès au marché leur est devenu de plus en plus difficile », détaille Rolf J. Langhammer de l’Institut pour l’économie mondiale de Kiel. C’est pourquoi elles ont suivi la recommandation du gouvernement allemand de diversifier leurs sources d’approvisionnement et leurs clients « de façon plus offensive que les grandes entreprises ». A l’inverse, ces dernières, y compris les constructeurs automobiles et BASF, ont dévoilé des plans sociaux en Allemagne tout en accélérant leurs investissements en Chine. Face à ce constat, les syndicats craignent qu’à long terme, la valeur ajoutée et les emplois les mieux rémunérés soient créés hors d’Allemagne. Les experts se demandent également comment vont réagir les politiques. « Vont-ils se laisser influencer par les intérêts des grandes entreprises, qui ont un accès privilégié à la chancellerie, ou par l’intérêt du pays et des emplois locaux ? », s’interroge Jürgen Matthes, économiste à l’Institut de Cologne. Entre-temps, la Chine continue d’exporter massivement ses produits manufacturés qui bénéficient d’importantes subventions publiques, notamment dans l’automobile et les technologies vertes – deux secteurs clé pour le « made in Germany ». Analysé par Le Monde |
| VOLKSWAGEN |
| Pour accroître sa force d’innovation locale, Volkswagen investit 2,5 milliards d’euros dans son centre de Hefei, en Chine orientale À l’occasion d’une visite officielle de trois jours du chancelier Olaf Scholz en Chine, le géant allemand de l’automobile Volkswagen a officialisé son projet d’investir 2,5 milliards dans son centre de R&D chinois de Hefei, à 450 kilomètres de Shanghai. Alors qu’il s’agissait déjà du plus important centre développement du groupe en dehors de son pays d’origine, celui-ci va voir ses effectifs passer de 1200 à 3000 salariés avant la fin de l’année. Patron de Volkswagen pour la Chine, Ralf Brandstätter a commenté : « cet investissement supplémentaire souligne notre ambition d’accroître rapidement notre force d’innovation locale. » Pour la firme de Wolfsburg, il s’agit de reconquérir au plus vite la place de premier vendeur de véhicules particuliers de l’empire du Milieu que lui a ravie le chinois BYD. Volkswagen entend s’appuyer sur son partenariat avec la licorne chinoise Xpeng pour commercialiser dès 2026 pas moins de quatre nouveaux véhicules intelligents et intégralement connectés, lesquels seront commercialisés entre 18 000 et 22 000 euros. Aux abords du centre d’innovation sera également érigé un parc fournisseurs géant de 450 000 mètres carrés qui accueillera plus de mille fournisseurs de logiciels et hardware, répondant ainsi à l’objectif d’un taux de localisation de 100%, selon le principe « en Chine pour la Chine ». L’enjeu de la réussite de ce que Volkswagen érige en « Silicon Valley » de l’empire du Milieu est pour le moins colossal pour le groupe qui réalise déjà les deux cinquièmes de son chiffre d’affaires en Chine, avec 39 usines qui y emploient quelque 90 000 salariés. En effet, de l’aveu du PDG Oliver Blume , ce n’est rien de moins que son avenir qui s’y dessine. Relayé par Les Echos |
| INDUSTRIE AUTOMOBILE |
| Les députés amendent la proposition de loi sur le verdissement des flottes d’entreprises Le 9 avril, les députés de la commission du Développement durable ont modifié la proposition de loi sur le verdissement des flottes d’entreprises de Damien Adam (Renaissance), avec « des obligations allégées » et des « sanctions alourdies ». Pour rappel, le champ de la loi s’applique à environ 50% des voitures neuves, d’où ses conséquences significatives pour le marché automobile français. Tout d’abord, concernant les changements adoptés par la commission, les seuils de 30% de voitures à batteries en 2025 et de 95% en 2032 ont été abaissés respectivement à 20% et 90%. Ensuite, les députés ont introduit un mécanisme d’Eco-score favorisant les voitures produites en France et en Europe, plus vertueuses en CO2. Grâce à ce dispositif, soutenu par l’industrie automobile française, « cinq voitures made in Europe achetées compteront pour six ». De leur côté, les think tanks et les ONG environnementales réclament un durcissement de ce mécanisme. D’après Jean-Philippe Hermine, directeur de l’Institut Mobilités en transition, « l’ajout de l’Eco-score est bénéfique, mais il faudrait instaurer également un malus en miroir pour l’achat de voitures qui ne correspondent pas aux critères ». Enfin, les députés ont augmenté les sanctions en cas de manquement des entreprises aux objectifs et ajouté une pénalité pour le non-respect de l’obligation de reporting de l’état de verdissement de leur flotte. L’Etat, lui, a été exempté de la trajectoire imposée aux grandes flottes d’entreprises. Le texte de la commission du Développement durable fera l’objet d’un débat à l’Assemblée nationale de 30 avril et ensuite passera au Sénat. Rapporté par Les Echos |
| AVANZA |
| Controverse autour de l’autorisation d’un herbicide pour la riziculture camarguaise Le 12 avril dernier était organisée à l’initiative su syndicat des riziculteurs de Camargue une manifestation devant la mairie des Saintes-Marie-de-la-Mer (Bouches-du-Rhône). Le rassemblement était organisé pour dénoncer la récente prise de position de l’édile, Christelle Aillet, laquelle avait annoncé le 30 mars dans un communiqué de presse qu’elle envisageait de demander un référé-suspension pour suspendre l’autorisation dérogatoire délivrée au titre de l’« urgence phytosanitaire » à l’herbicide Avenza pour la période du 15 mars au 15 juillet par le ministère de l’Agriculture. Il faut dire que l’herbicide en question ne bénéficie pas d’homologation à l’échelon européen, et que l’Agence européenne des produits chimiques considère qu’il est porteur de molécules particulièrement toxiques pour les milieux aquatiques. Ce qui pose problème dans la seule région rizicole de France (12 000 hectares, 150 exploitants pour 70 000 tonnes annuelles de riz) dans la mesure où les eaux des rizières rejoignent toutes l’étang de Vaccarès, le Petit-Rhône, où se situe la station de pompage des Saintes-Marie-de-la-Mer et leurs 2600 habitants. Bertrand Mazel, qui préside le syndicat des riziculteurs, dénonce : « nous sommes les plus vertueux, mais on nous demande d’être encore plus vertueux. Nous avons le moins de traitements à l’hectare de tous les producteurs de riz, et 25 % de la culture est produite en bio. Nous avions 1 500 molécules autorisées, il y a quelques années, il en reste moins de 500. La filière avance mais trouver des alternatives demande du temps. » Il affirme : « la molécule – le benzobicyclon – contenue dans l’Avanza se dégrade très vite, on ne la retrouve pratiquement plus après trente jours. C’est beaucoup moins nocif que tous les produits ménagers utilisés dans les maisons ». Ce à quoi le président de la Société nationale de protection de la nature, l’association qui gère les 13 000 hectares de la Réserve naturelle nationale de Camargue, Rémi Luglia, rétorque : « Les molécules de ce nouveau produit ne sont pas détectables, ce qui ne signifie pas qu’il n’y en a pas (…). N’y a-t-il pas un paradoxe à ce qu’on autorise un produit qu’on ne peut pas tracer ? Je trouve dommage qu’on ait accordé cette autorisation alors qu’il faudrait mettre en place une orientation plus incitative vers des pratiques vertueuses. » Du côté du parc naturel régional de Camargue et de son directeur, Christophe Fontfreyde, c’est un autre son de cloche qui se fait entendre : « Aujourd’hui, il n’est pas possible de faire du bio partout, en Camargue, pour une question de salinité. » Il avance, pragmatique : « Nous voulons objectiver les choses. Il va falloir s’interroger sur l’utilisation de molécules chimiques en Camargue, et se poser les questions : où rejette-t-on les eaux résiduelles des rizières ? Est-il possible ou non de déplacer la station de pompage qui alimente la commune des Saintes-Marie-de-la-Mer ? » Source : Le Monde |
| ENVIRONNEMENT |
| Justice climatique : la CEDH condamne la Suisse Avec un arrêt « à la portée symbolique forte » rendu le 9 avril, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a condamné la Suisse pour « inaction climatique » à la suite d’une requête de 2 500 femmes faisant partie de l’association « Aînées pour la protection du climat ». Les plaignantes avaient dénoncé les « manquements des autorités suisses pour atténuer les effets du changement climatique », ce qui aurait entraîné des conséquences négatives sur leur santé. Dans le détail, la CEDH a statué que la Suisse avait enfreint la Convention européenne des droits de l’homme au titre de son article 8, qui garantit « le droit au respect de la vie privée et familiale ». Ce jugement, la première condamnation de ce type au niveau européen, participe ainsi d’un « mouvement d’écologisation des droits de l’homme », estime Emmanuelle Brunelle, associée du cabinet DTMV Avocats. Et d’expliquer que «la Suisse est à présent tenue de prendre des mesures. Le suivi de ses actions sera assuré par le comité des ministres des affaires étrangères des 46 États membres de la CEDH, qui ont le droit de saisir à nouveau les juges si aucun progrès n’est constaté ». Pour sa part, Jérémie Suisse, délégué général de l’association française « Notre affaire à tous », souligne que la décision de la CEDH marque un tournant dans le combat juridique contre le changement climatique. « Les Etats européens […] ne peuvent plus ignorer les tribunaux. La question climatique est une menace directe et immédiate pour les droits fondamentaux, il faut agir de manière beaucoup plus ambitieuse. Ou les contentieux se multiplieront ». Deux autres affaires portées devant la CEDH, qui visaient la France et le Portugal, ont en revanche été rejetées. Issu de La Croix |