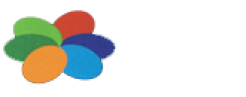L’actualité de la semaine: Les Echos lèvent cette semaine le voile sur la crise structurelle qui affecte la chimie allemande depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Une crise qui oblige les acteurs du troisième secteur industriel d’outre-Rhin (derrière l’automobile et la machine-outil) à se réinventer, à l’instar de BASF dont La Croix nous présente les actions engagées sur son site historique de Ludwigshafen. Dans les Echos encore, nous sont dévoilés les très bons chiffres de l’année 2023 en termes d’électrification du parc automobile tricolore. Le Monde met de son côté en lumière les difficultés auxquelles fait face l’industrie automobile allemande, avec en toile de fond cette même transition vers l’électrique. Par la sélection variétale, les chercheurs s’emploient à dynamiser la consommation de fruits et légumes, nous informe Le Parisien dans un article qui met à l’honneur des innovations telles que les raisins et pastèques sans pépin, ou encore l’oignon dépourvu de tout effet lacrymogène. Enfin, le quotidien économique de référence nous expose l’enjeu crucial de la présidence belge du Conseil de l’Union européenne (UE) au premier semestre 2024, à savoir la finalisation de l’adoption de plusieurs textes du Pacte vert avant les élections européennes qui se tiendront en juin prochain. Dans la presse cette semaine CHIMIE ALLEMANDE Le secteur chimique allemand confronté à une crise structurelle inédite « Nous nous trouvons au milieu d’une longue et profonde dépression. Et on ne sait pas encore combien de temps cela prendra pour en sortir » : tels sont les propos tenus par le président de la Fédération allemande de l’industrie chimique (VCI), Markus Steilemann, à l’occasion de sa présentation du bilan de fin d’année 2023. Il faut dire que les chiffres sont édifiants : après avoir connu en 2022 une chute de sa production de 10% par rapport à l’année précédente, c’est une nouvelle baisse de 11% sur un an qu’a enregistrée la chimie allemande en 2023. « Plus cette situation durera, plus nous devrons nous attendre à ce que d’autres installations soient fermées » a poursuivi Markus Steilemann. Troisième secteur industriel outre-Rhinderrière l’automobile et la machine-outil, la chimie allemande est la première d’Europe, et ses dirigeants étaient jusqu’ici apparus comme les « seigneurs de l’industrie ». Après une année 2022 déjà rendue difficile par l’invasion de l’Ukrainepar la Russie et l’arrêt des importations de gaz russe au cœur de leur stratégie énergétique, plus de la moitié des acteurs du secteur chimique allemand ont vu leursprofits se contracter en 2023, voire ont dû faire face à des déficits. Et la reprise ne se profile guère à l’horizon immédiat : une stabilité de la production est attendue pour cette année. La VCI établit qu’un tiers de ses membres espèrent une reprise au second semestre 2024, quand 45% ne l’envisagent qu’à partir de 2025 ou même au-delà… Dans ce contexte, 27% des entreprises du secteur s’apprêtent à diminuer leurs investissements sur le territoire allemand, et 25% d’entre elles se préparent à opérer une délocalisation de leur production. Des changements paradigmatiquessont également à l’œuvre, à l’instar de BASF qui a annoncé renoncer à son modèle historique intégré pour conférer plus d’autonomie à ses pôles phytosanitaires, dematériaux pour batteries et de coatings. Une manière de pouvoir mieux valoriser ses différentes activités sur les marchés calquée sur un modèle anglo-saxon. Jusqu’où ira la descente aux enfers de la chimie allemande ? La question se pose alors que la concurrence nord-américaine est notamment dopée par le gaz de schiste, et que leProche-Orient s’emploie aujourd’hui à remonter la chaîne de valeur du pétrole vers leplastique. Seule certitude : le modèle allemand, pensé dans une perspective defourniture d’énergie bon marché par le gazoduc Nord-Stream, a été littéralementbattu en brèche par le conflit ukrainien, et doit aujourd’hui être intégralementréimaginé. Couvert par Les Echos BASF Les difficultés de l’industrie chimique allemande illustrent la crise économique du pays Le 15 janvier, l’Allemagne a déclaré avoir enregistré une récession en 2023, avec unrecul de 0,3% de son PIB. Cette contre-performance est en partie due aux difficultés rencontrées par son industrie, en particulier par la chimie, qui est le troisième secteur industriel et troisième plus gros exportateur d’Allemagne. A titre d’exemple, tout comme ses concurrents, BASF fait face à des défis de taille, dont l’affaiblissement de la demande mondiale, la transition écologique et la hausse des coûts énergétiquesà la suite du conflit en Ukraine. Pour s’adapter à cette situation, le chimiste allemand a choisi de supprimer 2 600 emplois sur le site historique de Ludwigshafen, avec la fermeture de l’une de ses deux usines d’ammoniac, et d’accélérer le processus de transformation écologique. « La transition écologique est l’un des principaux défis de BASF, souligne un porte-parole du groupe. Nous testons et développons sur place à Ludwigshafen de nouvelles techniques ». Parmi les innovations testées figurent unnouveau système d’électrolyse de l’eau, visant à produire 8 millions de tonnes d’hydrogène décarboné dès 2025, et un four de vapocraquage fonctionnant non pas au gaz mais à l’électricité. De plus, BASF a décidé de faire sortir de son fameux « système intégré » trois de ses activités principales – l’agriculture, les matériaux pour revêtements et ceux pour batteries électriques – afin de gagner en flexibilité. Malgré les craintes des syndicats, le groupe exclut les scénarios « catastrophistes » entraînant des délocalisations et une désindustrialisation. « Nous sommes convaincus que toutes les mesures que nous prendrons renforceront la performanceet la résistance du site de Ludwigshafen à long terme », affirme le porte-parole. De son côté, la fédération de la chimie allemande (VCI) a émis des réserves sur lacompétitivité des chimistes allemands à l’avenir. Entretemps, BASF continue àinvestir en Chine et a même nommé l’actuel chef de la région Asie, Markus Kamieth, à la présidence de son directoire.
Analysé par La CroixÉLECTRIFICATION DES VÉHICULES 2023, année charnière en termes d’électrification du parc automobile tricolore Alors que la vente de véhicules à moteur thermique sera proscrite au sein de l’Union européenne à l’horizon 2035, le parc automobile tricolore a franchi au cours de l’année 2023 des étapes importantes sur la voie de la décarbonation. Au premier rang desquelles le franchissement du cap du million de véhicules électriques immatriculés sur le territoire hexagonal : AAA Data, partenaire de l’Avere, l’association nationale pour le développement de la mobilité électrique, a ainsi établi qu’au 31 décembre dernier, 1,06 million de véhicules électriques avaient été mis en circulation en France depuis 2010. Rien que sur l’année 2023, quelque 328 000 véhiculesélectriques ont été immatriculés en France, ce qui représente 16,8% des ventes de voitures. Dans ses prévisions, le Secrétariat général pour la planification écologique (SGPE) table sur deux véhicules vendus sur trois qui seront intégralement électriques à l’horizon 2030. Des perspectives que pourrait néanmoins contrarier le coup de rabotopéré par le gouvernement en 2024 sur le bonus écologique à l’achat d’une voiture électrique… Parmi les autres grands enseignements de l’année 2023 figure l’insolent succès de Tesla, qui a multiplié par plus de deux ses ventes par rapport à l’année précédente pour les porter à 63 041 unités. La firme d’Elon Musk a vendu 37127exemplaires de son Model Y, le véhicule électrique le plus vendu en France, et 24 359 Model 3. Du côté français, si Stellantis est parvenu à garder 23,5% de parts de marché, en recul de trois points sur un an, Renault et son allié Nissan ont vu leurs parts chuter de près de neuf points, atteignant 21,4%, soit l’équivalent de Tesla. Une dernière étape franchie en 2023 en termes d’électrification du parc automobile français a trait au déploiement du réseau de bornes de recharge. Cumulant 44% de hausse sur l’année, leur nombre a d’après l’Avere dépassé le stade symbolique des 100 000 en mai dernier et atteignait les 118 000 fin décembre, soit un point de recharge pour 175 habitants. Présenté par Les Echos INDUSTRIE AUTOMOBILE ALLEMANDE L’industrie automobile allemande perd en compétitivité L’industrie automobile allemande, qui a généré 506 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2022 et représente 15,4% des exportations du pays, a perdu en compétitivité, sur fond de transition vers l’électrique. Parmi les signes de cette crise figurent le plan d’économies annoncé le 19 décembre par Volkswagen, lasuppression de 1 500 emplois d’ici à 2025 par Bosch, premier sous-traitant automobile du monde, et les plans de réduction des coûts des équipementiers Continental et ZF. En sus des contraintes sur les coûts de production, le secteur automobile allemand subit des « chocs simultanés » sur la demande : le ralentissement de la vente des véhicules à cause de la récession économique,l’adoption plus lente que prévu de la voiture électrique et l’arrêt des subventionspubliques aux acheteurs des véhicules électriques. « L’incertitude sur les subventions est une menace pour la montée en puissance des marques dans l’électrique en Allemagne », rappelle Ferdinand Dudenhöffer, directeur du Centre pour la recherche automobile de Bochum. La concurrence accrue sur l’électrique et le logiciel automobile ainsi que les délocalisations en Chine, en Europe de l’Est ou aux Etats-Unismenacent également la filière automobile allemande. Cette situation pourrait entraîner des conséquences sociales importantes, telles qu’une possible baisse de la rémunération élevée des emplois industriels dans l’automobile. C’est pourquoiplusieurs responsables politiques allemands s’opposent à la fin du moteur thermique en 2035 décidée par l’Union européenne, et accusent ce choix de favoriser la « domination chinoise » dans le secteur automobile.
Paru dans Le MondeTENDANCES ALIMENTAIRES Par la sélection variétale, les chercheurs s’emploient à dynamiser la consommation de fruits et légumes Sur les étals des supermarchés, de nouveaux produits sont proposés depuis quelques années, à l’instar des raisins et des pastèques sans pépins, des oignons dépourvusde leur effet lacrymogène, ou encore de baby kiwis que l’on peut déguster sans les éplucher grâce à leur peau dénuée de toute pilosité. Ces innovations sont le fruit d’un travail de sélection variétale qui est réalisé en vue de satisfaire au mieux les attentes des consommateurs et, partant, de stimuler les ventes. Auparavant dénigrées pour leur amertume, les endives proposées aujourd’hui sont beaucoup moins amères consécutivement au travail de sélection variétale dont elles ont fait l’objet. L’évolution des goûts a abouti à ce que soient aujourd’hui préférés des melonsou des tomates plus fermes qu’autrefois. David Corré, responsable en France du semencier BASF, explique : « aujourd’hui, les jeunes recherchent un certain contraste dans les textures. Ils veulent du croquant. » Pour pouvoir proposer du raisin sans pépins, pas moins de quinze années de travail de sélection ont été nécessaires. Une innovation qui, si elle répond effectivement à une attente des consommateurs, n’est pas exempte de critiques que soulève la nutritionniste Sophie Janvier : « les pépins de raisins contiennent des acides gras poly-insaturés indispensables (notamment des omégas 6), des fibres et des polyphénols antioxydants. » Pour ce qui est de l’oignon qui ne fait pas pleurer, pas moins de trente années de recherche ont été nécessaires. Le travail de sélection variétale a par ailleurs permis de mettre au point de nouvelles variétés de légumes secs plus faciles à cuisiner. Sur la plateau de Saclay, l’Institut national de la recherche agronomique (Inrae) phosphore actuellement à la mise au point de légumineuses qui soient plus faciles à digérer. Notons pour conclure que l’Inrae s’emploie en parallèle à réhabiliter des variétés qui ont pu être abandonnées en raison de leur couleur, à l’image de Véronique Decroocq, directrice de recherche, qui appelle à s’affranchir de la dictature du rouge pour l’abricot : « avant qu’il ne soit domestiqué, l’abricot présentait de multiples couleurs. Dans ses régions d’origine, l’abricot le plus prisé est blanc. On le retrouve toujours à l’état sauvage sur les contreforts de l’Himalaya. Il est tellement gorgé de sucre qu’on a l’impression d’avoir du miel dans la bouche. » Source : Le Parisien POLITIQUE CLIMATIQUE EUROPÉENNE Pacte vert : la présidence belge vise à finaliser l’adoption de plusieurs textes La présidence belge du Conseil de l’Union européenne (UE), qui a commencé le 1er janvier, devra relever un défi majeur : finaliser l’adoption de plusieurs textes du Pacte vert avant les élections européennes de juin. Présenté en 2019, le Pacte vert, qui inclut presque soixante-quinze textes législatifs, vise à atteindre la neutralité carbone dans l’UE d’ici 2050. Une trentaine de textes ont déjà été adoptés. Toutefois, faire avancer les autres s’annonce difficile, et cela pour plusieurs raisons, dont la crise climatique mondiale ainsi que l’opposition des conservateurseuropéens et de l’industrie. La présidence belge souhaite prioriser l’économie circulaire, la transition écologique juste et l’accélération de la transition énergétique, notamment vers les énergies renouvelables. Alexander De Croo, lePremier ministre belge, a notamment insisté sur la nécessité de « mieux concilier climat et économie » dans la phase finale de ces efforts. Les observateurs rappellent d’ailleurs que « le temps presse », puisque le nouveau Parlement européen issu des élections risque d’être moins sensible que l’actuel aux enjeux climatiques. « Ce que la Belgique ne réalisera pas restera à finaliser par les présidences hongroise et éventuellement polonaise – prévues entre juillet 2024 et juillet 2025 -, ensemble, avec le nouveau Parlement et la nouvelle Commission, avec un risque de retard considérable… », craint le Bureau européen de l’environnement (BEE), coalition d’ONG. Entretemps, la Commission européenne réfléchit à une nouvelle cible de réduction des émissions nettes de gaz à effet de serre à l’horizon 2040, par rapport aux niveaux de 1990. Concrètement, le 6 février, l’exécutif européen dévoileraplusieurs scénarios pour cet objectif intermédiaire. Ensuite, après les élections, la future Commission se basera sur ces travaux pour proposer une modification de la loi européenne sur le climat.
Rapporté par Les Echos