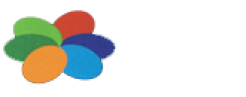| L’actualité de la semaine: |
| Les Echos rendent cette semaine compte de l’inauguration par BASF, le 16 avril dernier, d’un démonstrateur industriel de vapocraqueur électrique sur son Verbund de Ludwigshafen, en Rhénanie-Palatinat. Une prouesse technologique qui constitue un jalon essentiel du virage vert du groupe et a inspiré à son PDG, Martin Brudermüller, ce commentaire enthousiaste : « avec le développement de fours de vapocraquage électriques, nous mettons la main sur une technologie clé qui peut aider à réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre de l’industrie chimique. » Dans sa version numérique, L’Usine Nouvelle nous relaie une autre avancée notable à inscrire à l’actif de BASF : la finalisation de la construction à Schwartzheide, en Allemagne, d’un prototype d’usine de recyclage des métaux des batteries lithium-ion. Après des résultats exceptionnels enregistrés en 2023, le marché des véhicules électriques est en ce début d’année en berne, nous informe Le Figaro qui s’attèle à décrypter les causes de cette soudaine désaffection. Toujours dans le quotidien qui scande à sa Une que “sans la liberté de blâmer, il n’est point d’éloge flatteur”, nous est proposée une analyse du rétropédalage à l’œuvre des Etats, des entreprises et des fonds d’investissement en termes de transition écologique. Enfin, dans les colonnes de La Croix, il est question du dernier rapport de la start-up Open Climat, laquelle a récemment analysé l’évolution des émissions de CO2 des 120 plus grandes multinationales manufacturières. L’occasion de mettre à l’honneur le trop peu d’entreprises “championnes du climat”, c’est-à-dire alignées sur une trajectoire de décarbonation compatible avec une limitation du réchauffement climatique à 2°C. |
| Dans la presse cette semaine |
| VAPOCRAQUEUR ÉLECTRIQUE |
| BASF inaugure un démonstrateur de vapocraqueur électrique, premier jalon de son virage vert Véritable « cœur industriel » de tout complexe pétrochimique, les vapocraqueurs assurent la transformation des produits pétroliers bruts en éthylène et propylène, lesquels entrent ensuite dans le processus de fabrication des plastiques. Ce « craquage » requiert des températures particulièrement élevées, de l’ordre de 850°C, générant une importante consommation de gaz ainsi que de grandes quantités d’émissions carbonées. En remplaçant l’alimentation en gaz par des énergies renouvelables, c’est jusqu’à neuf dixièmes des émissions des vapocraqueurs qui pourraient être évitées. D’où l’éminent intérêt du démonstrateur industriel inauguré le 16 avril dernier par BASF sur son Verbund de Ludwigshafen, en Rhénanie-Palatinat. À savoir : deux fours chauffés à l’électricité sur son vapocraqueur. Martin Brudermüller, PDG de BASF, s’est pour l’occasion livré à ce commentaire enthousiaste : « avec le développement de fours de vapocraquage électriques, nous mettons la main sur une technologie clé qui peut aider à réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre de l’industrie chimique. » Afin de construire cette unité pilote, BASF a déboursé quelque 70 millions d’euros ces trois dernières années en association avec le saoudien Sabic et le groupe d’outre-Rhin Linde. Si les résultats sont concluants, un démonstrateur dix fois plus important pourrait voir le jour, sous réserve « de la disponibilité d’énergies renouvelables à des prix compétitifs », fait-on valoir chez BASF. Le géant allemand de la chimie table aujourd’hui sur un doublement ou triplement de sa demande mondiale d’électricité dans les temps à venir. Sans quoi le groupe ne parviendra à tenir son objectif de neutralité carbone à l’horizon 2050. Vapocraquage électrique, hydrogène et Carbon Capture Storage (CCS) seront les trois piliers de sa décarbonation. L’enjeu est de taille pour le groupe aux 111 000 salariés qui connaît une conjoncture défavorable : alors que ses bénéfices se sont contractés de 45% en 2023, le groupe doit mettre entre 3 et 4 milliards sur la table d’ici 2030, auxquels devraient ensuite s’ajouter au moins 10 milliards supplémentaires. Repéré par Les Echos |
| RECYCLAGE DES MÉTAUX DE BATTERIES LITHIUM-ION |
| BASF finalise la construction d’une usine-pilote de recyclage des métaux sur son site allemand de Schwartzheide « Avec la croissance rapide attendue du marché des véhicules électriques, le recyclage des batteries offre un accès compétitif et durable aux métaux critiques » : tel est le constat dressé par le responsable des matériaux pour batteries et des activités de recyclage des batteries chez BASF, Daniel Schönfelder. C’est pourquoi la finalisation de la construction à Schwartzheide, en Allemagne, d’un prototype d’usine de recyclage des métaux des batteries lithium-ion, reposant sur une technique innovante d’extraction du lithium, du nickel, du cobalt, du manganèse et du cuivre des batteries en fin de vie, constitue un franc succès pour le groupe. Par ailleurs, le leader mondial de la chimie continue sur le même site de construire une usine de blackmass, produite à partir du broyage mécanique des batteries, et de laquelle sont extraits les métaux qui serviront à produire de nouveaux matériaux actifs cathodiques. Ainsi, avec la finalisation de cette usine-pilote, BASF peut aujourd’hui se targuer d’ériger à Schwarzheide « le premier centre européen de production de matériaux pour batteries et de recyclage de batteries ». Relayé par usinenouvelle.com |
| MARCHÉ DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES |
| Coup de frein sur les ventes de voitures électriques Après une année 2023 florissante, le marché des véhicules électriques est à la peine en ce début d’année 2024. Au mois de mars, seules 134 400 nouvelles immatriculations de véhicules électriques ont été enregistrées sur le continent européen, soit une baisse de 11,3% sur un an. Alors qu’elle atteignait les 14,6% en 2023, la part des ventes de véhicules intégralement électriques plafonne aujourd’hui à 13% en Europe. C’est encore pire aux États-Unis où, dans un contexte de prix des carburants historiquement bas et d’un marché des prêts grippé, les « BEV » (pour Battery Electric Vehicle) n’atteignaient même pas l’année dernière les 8% de parts de marché. Côté européen, un des facteurs explicatifs du désengouement des consommateurs se situe dans l’arrêt brutal des subventions étatiques tel qu’il a été décidé au Royaume-Uni, en Norvège, et surtout en Allemagne en septembre dernier. La France fait figure d’exception dans la mesure où les ventes de véhicules électriques ont augmenté de 10% en mars. Ce qu’ Éric Champarnaud, consultant pour C-Ways, tempère : « une partie de cette progression tient aux effets différés du leasing social et de l’anticipation de la baisse du bonus écologique. » En effet, le gouvernement a fait savoir en décembre dernier qu’il envisageait de raboter de 1000 euros le bonus écologique à l’achat de véhicule électrique neuf pour les ménages les plus aisés, et d’exclure du dispositif les voitures chinoises dès cette année. « Ces annonces en cascade ont incité les acheteurs à se ruer chez leur concessionnaire, d’où un effet à la hausse observé sur les immatriculations en ce début d’année », observe le spécialiste. Guillaume Crunelle, expert automobile pour Deloitte, s’appuie sur l’exemple allemand pour observer : « le marché de l’électrique n’a pas encore atteint une maturité suffisante pour se passer des aides publiques. Quand on coupe le robinet des coups de pouce à l’achat, le marché s’effondre. » Son homologue chez Publicis Sapient, Pierre Gerfaux, poursuit : « les constructeurs ont commencé à pénétrer le marché avec des véhicules haut de gamme, qui ont séduit les clients les plus aisés portés sur la technologie et l’écologie. Passé les primo-acquéreurs, il faut convaincre le gros de la population de basculer. » Pour ce faire, les constructeurs se livrent aujourd’hui à une féroce guerre des prix, à l’image de Tesla, qui multiplie les remises, ou de Renault, Citroën et Volkswagen, qui s’apprêtent à lancer des modèles à des prix inférieurs à 25000 euros. « Le ralentissement actuel est transitoire : quand ces modèles plus abordables arriveront sur le marché, l’électrique connaîtra un nouveau souffle », veut croire Éric Champarnaud. Cette bataille des prix, condition sine qua non à la démocratisation des « wattures » pourrait être favorisée par l’effondrement des cours des minerais utilisés pour les batteries. Un autre catalyseur pourrait venir du champ règlementaire : rappelons que l’UE s’est engagée à bannir à l’horizon 2035 les véhicules thermiques sur son sol et que la règlementation CAFE (pour Corporate Average Fuel Economy), qui impose un seuil d’émissions carbonées à chaque constructeur automobile, est déjà en vigueur et doit être abaissée dès 2030 (à 59 grammes de CO2 par kilomètre). Sa non-application exposerait les contrevenants à des sanctions financières astronomiques, menacent les autorités européennes. Décrypté par Le Figaro |
| TRANSITION ÉCOLOGIQUE |
| Transition écologique : les Etats, les entreprises et les fonds d’investissement rétropédalent Depuis quelques temps, l’Union européenne, les entreprises et les fonds d’investissement semblent réduire ou remettre en question leurs engagements en faveur de la transition écologique. Tout d’abord, la Commission européenne, qui avait fait de la lutte contre le changement climatique l’une de ses priorités, a dû reculer sur plusieurs mesures de son « pacte vert », telles que la suppression des subventions aux énergies fossiles ou la loi divisant par deux l’usage des pesticides d’ici 2030. Plusieurs facteurs expliquent ce rétropédalage, dont la crise du monde agricole, les critiques des industriels, la perte de compétitivité européenne et la hausse des prix. Ensuite, les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) font l’objet de débats politiques houleux aux Etats-Unis, où l’ESG est « perçu comme une vision démocrate », selon Estelle Brachlianoff, la directrice générale de Veolia. D’ailleurs, « les entreprises peuvent se retrouver sous le feu des critiques car elles ont l’air de mettre en avant des objectifs environnementaux plutôt que des objectifs financiers », ajoute Louise Schreiber, responsable de la recherche ESG chez Mirova. Concrètement, Unilever et Shell ont récemment annoncé une réduction de leurs objectifs ESG, tandis qu’en France les résolutions sur le climat soumises aux actionnaires lors des assemblées générales sont moins nombreuses que l’an dernier. Enfin, la finance verte semble moins prisée. A titre d’exemple, au premier trimestre 2024, les émissions mondiales d’obligations d’entreprises finançant des projets environnementaux ou sociétaux ont diminué de 10%. Néanmoins, malgré ce contexte, les experts européens se disent optimistes. « La prise de conscience des entreprises s’est accélérée en Europe. Et l’entrée en vigueur en 2025 de la directive européenne (CSRD) fixant de nouvelles obligations de reporting extra-financier aux sociétés cotées devrait permettre d’accélérer les efforts de transition », estime Éric Campos, directeur de l’engagement sociétal au Crédit agricole SA. Analysé par Le Figaro |
| DÉCARBONATION |
| Open Climat met en avant les entreprises « championnes du climat » Le rapport de la start-up Open Climat, qui se base sur le référentiel SBTi (Science Based Targets initiative), a récemment analysé l’évolution des émissions de CO2 des 120 plus grandes multinationales manufacturières. Le constat est sans appel : seules 21 de ces entreprises, dont sept françaises (Danone, Sodiaal, Bel, Sanofi, Hermès, Kering et LVMH), étaient alignées sur une trajectoire de décarbonation compatible avec une limitation du réchauffement climatique à 2°C. De plus, seules trois au niveau mondial (Burberry, GlaxoSmith-Kline et Sodiaal) sont alignées sur une trajectoire permettant la limitation du réchauffement à 1,5°C. Si le cofondateur d’Open Climat, Vincent Pappolla, admet que « c’est encore trop peu », il souligne aussi que « mettre en valeur les bons élèves permet de montrer que tenir les objectifs est possible ». Le rapport montre également que parmi les entreprises « championnes du climat » figurent surtout des géants du luxe et de l’agroalimentaire. « Dans le luxe, l’enjeu réputationnel est très fort, si bien que les entreprises ont un intérêt à la décarbonation. Ce sont également des secteurs où la baisse des émissions s’est enclenchée plus tôt que dans d’autres, comme l’industrie pharmaceutique », détaille Vincent Pappolla. Toutefois, le classement d’Open Climat n’aborde pas les engagements futurs des entreprises évaluées, contrairement à celui de l’ONG Carbon Market Watch, qui publie chaque année un rapport sur les engagements des sociétés. Le dernier, paru le 9 avril, indique que seules deux entreprises sur 20 dans 4 secteurs (transports, énergie, alimentation et agriculture) avaient adopté des plans climat « à l’intégrité raisonnable ». Rapporté par La Croix |