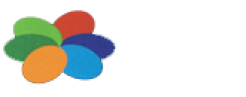| L’actualité de la semaine: |
| Les Echos relaient cette semaine les très mauvais chiffres présentés par BASF en termes de bénéfices avant intérêt et impôt : à 3,8 milliards d’euros sur l’année 2023, ils sont en contraction de 45% sur un an. Ce qui a contraint le groupe à rendre publics avec près d’un mois d’anticipation ses résultats annuels. Après trois années de repli, le marché automobile européen a retrouvé des couleurs en 2023 : il a notamment été porté par les ventes de véhicules électriques, nous apprend Le Figaro. L’électrification de l’automobile profite pleinement sur le plan industriel à la Lorraine, et plus précisément à la Moselle, découvre-t-on dans les colonnes du Monde. Le think tank Le Millénaire, dans la deuxième édition de son étude consacrée aux grandes implantations industrielles qui pourraient être réalisées sur le territoire français en 2024, en identifie six qui nous sont présentées par le quotidien libéral L’Opinion. Enfin, Les Echos mettent à l’honneur quelques-unes des start-up françaises du secteur de la construction qui œuvrent au développement de nouveaux matériaux bas carbone. |
| Dans la presse cette semaine |
| RÉSULTATS 2023 |
| Chute vertigineuse des bénéfices et contraction du chiffre d’affaires : le « seigneur de la chimie » BASF tombe de son piédestal Outre-Rhin, le secteur de la chimie est aux abois, ainsi qu’en témoigne la chute vertigineuse des bénéfices avant intérêt et impôt annoncée le 19 janvier dernier par BASF pour l’année 2023. Sur un an, ceux-ci se sont contractés de 45% pour atteindre les 3,8 milliards d’euros, bien en-deçà des 4 à 4,4 milliards qui étaient escomptés. Une distorsion qui a contraint le fleuron de l’industrie allemande à rendre publics avec près d’un mois d’anticipation ses résultats annuels, lesquels font état d’un chiffre d’affaires atteignant les 68,9 milliards d’euros sur l’année 2023, en contraction de 20% par rapport à 2022. « La diminution des marges liées aux ventes n’a pas pu être compensée par la réduction des coûts fixes réalisée », se justifie le groupe qui pourtant mis en place en février de l’année dernière un vaste de plan de restructuration impliquant fermetures d’usines et suppression d’un dixième des emplois en Allemagne. Nonobstant quelque 8 milliards de trésorerie, le groupe dont Markus Kamieth prendra prochainement la tête pourrait être en peine de financer sa transition énergétique. Les 2,15 milliards d’argent frais qu’il espérait dégager de la vente de sa filiale Wintershall Dea au britannique Harbour Energy pourraient finalement faire défaut dans la mesure où les autorités allemandes s’apprêtent à empêcher la transaction. Ce au nom de la souveraineté du pays en termes de production de pétrole et de gaz, ainsi que l’a révélé le quotidien économique Handelsblatt. Le seigneur de la chimie allemande n’est pas le seul de sa catégorie à connaître des déboires économiques : son homologue pharma-chimique Bayer annonçait la semaine dernière être parvenu à un accord avec les syndicats en vue d’une vaste restructuration, avec à la clé des milliers de postes supprimés. Anna Wolf, de l’institut d’économie de Munich, l’Ifo, ne témoigne guère d’un grand optimisme en livrant cette analyse : « le creux de la vague semble certes avoir été atteint dans le secteur, mais une remontée prochaine n’est pas encore en vue. » Relayé par Les Echos |
| INDUSTRIE AUTOMOBILE |
| L’essor de la voiture électrique en Europe La hausse des ventes de véhicules électriques a contribué à la relance du marché automobile européen en 2023, après trois ans de repli. Avec 14,6% de part de marché, les voitures électriques ont dépassé pour la première fois sur une année entière les véhicules à diesel (13,6%). Néanmoins, il existe des disparités entre les pays de l’Europe du Nord et ceux de l’Europe du Sud. A titre d’exemple, en Suède et au Danemark, la part de marché des voitures électriques s’élève à presque 40%, contre 4% en Italie. En Allemagne et en France, la part de ventes de véhicules électriques était respectivement de 18,4% et 16,8%. Si le taux de pénétration des voitures électriques en Europe est censé augmenter en raison de la fin des ventes de véhicules thermiques neufs en 2035, plusieurs facteurs pourraient influencer cette dynamique, dont le pouvoir d’achat des consommateurs, la qualité de l’infrastructure de recharge et les subventions proposées par les gouvernements. L’émergence d’un marché de l’occasion pour les voitures électriques devrait également démocratiser ce type de véhicules. Les données sont encourageantes : en France, selon l’Observatoire La Centrale, les annonces de véhicules électriques d’occasion ont augmenté de 180% par rapport à fin 2022 ; leur prix a considérablement baissé. De plus, le lancement de modèles à batteries moins chers en 2024, tels que la Citroën ë-C3, et les véhicules des constructeurs chinois BYD et MG pourraient dynamiser le marché. Côté constructeurs, Tesla et MG Motors affichent les meilleurs résultats pour ce qui est des ventes de véhicules électriques. Toutefois, les groupes historiques, dont Volkswagen et Stellantis, restent en tête des classements des voitures vendues. Paru dans Le Figaro |
| RÉINDUSTRIALISATION LORRAINE |
| La Moselle, nouvelle place forte de l’industrie automobile En septembre dernier, le magazine Challenges évoquait dans sa rubrique confidentielle que la zone industrielle mosellane d’Hambach pourrait accueillir le mastodonte chinois SAIC pour y produire une voiture électrique ou hybride commercialisée sous la marque MG. Un projet que les élus locaux se refusent pour l’heure de commenter : « trop prématuré », ce serait « contre-productif à ce stade ». Toujours est-il que cette perspective fait pleinement sens dans une région que caractérisent sa proximité avec l’Allemagne, premier producteur et équipementier du continent, et des aides régionales et départementales des plus attractives. Moselle Attractivité, l’agence de développement du conseil départemental, avance : « c’est le fruit d’une vraie volonté politique de réindustrialisation, consécutive aux déclins des mines et de la sidérurgie. » Ainsi, le territoire abrite déjà deux usines du groupe Stellantis, qui vient d’y investir sur son site messin 60 millions d’euros dans une ligne de production de boîtes hybrides, en partenariat avec le belge belge Punch Powertrain. En parallèle, Stellantis a investi 100 millions d’euros sur son site de Trémery dans la coentreprise fondée en 2018 avec le japonais Nidec Leroy-Somer, dénommée Emotors, qui vise à produire annuellement 1,4 million de moteurs électriques à compter de l’année prochaine. Des groupes comme le constructeur britannique Ineos, le pneumaticien allemand Continental, ou encore le fabricant de pompes pour automobiles Pierburg, sont également implantés dans le département. Ce que Moselle Attractivité justifie ainsi, surtout à propos des acteurs allemands : « ils trouvent ici ce qu’ils appellent la règle des 3 P : platz, personal et prim (un lieu, du personnel et des primes). Soit de la surface, une main-d’œuvre accoutumée à l’industrie et les aides de la région et du département. Et un état d’esprit similaire, avec beaucoup de bilinguisme. » Des atouts déterminants à l’heure où les acteurs de l’automobile sont « tous sont à un virage » et que « c’est pour eux une question de vie ou de mort », observe Moselle Attractivité. Analysé par Le Monde |
| IMPLANTATIONS INDUSTRIELLES |
| Le think tank Le Millénaire identifie six projets de méga-usines qui ne doivent pas échapper à l’Hexagone en 2024 Dans la deuxième édition de son étude consacrée aux grandes implantations industrielles qui pourraient être réalisées sur le territoire français en 2024, le think tank Le Millénaire en identifie particulièrement six. Ceux-ci pourraient représenter jusqu’à 6,5 milliards d’euros d’investissements et générer de l’ordre de 6500 emplois. Dans le secteur de la santé, est potentiellement attendue l’usine européenne à technologie ARNm de l’américain Moderna et dont le PDG français, Stéphane Bancel, a fait part de son intérêt pour son pays d’origine. Mais, pour l’heure, aucune annonce concrète n’a été faite concernant ce projet avoisinant le milliard d’euros. Il en est de même dans le secteur automobile avec Tesla : « Elon Musk entretient volontairement le flou et rencontre régulièrement les dirigeants de ce monde pour parler de potentiels investissements industriels », observe le consultant spécialisé Guillaume Cau qui contribue au think tank Le Millénaire. Spécialisé dans les batteries à haute puissance, le groupe estonien Skeleton Technologies hésite entre la France, la Finlande ou l’Allemagne, pour son projet d’usine à 550 millions d’euros. Chez le belge Umicore, l’implantation d’une usine de recyclage de batteries à 500 millions d’euros est envisagée soit dans le Nord de la France, soit en Flandre belge. Un cinquième projet en discussion est celui du partenariat entre le sud-coréen Wscope et le français Alteo pour une usine de production de films séparateurs dans les Hauts-de-France, chiffrée à 600 millions d’euros. Enfin, la France souhaiterait attirer sur son sol un constructeur chinois de véhicules électriques : Saic MG, Chery et Great Wall Motors seraient sur les rangs. Si la France dispose incontestablement d’atouts avec son énergie nucléaire décarbonée, son volontarisme étatique et son positionnement géographique, elle fait également face à des faiblesses telles que la lourdeur de sa fiscalité, la rareté de son foncier ou encore son insécurité juridique. Alors que l’industrie représente 14,8% du PIB au niveau européen, cette part plafonne à 9,5% dans l’Hexagone. Dès lors, « attirer trois de ces six projets serait un très beau résultat pour la France », analyse Guillaume Gau. Présenté par L’Opinion |
| GREENTECH |
| Les start-up françaises misent sur les matériaux bas carbone Alors que le secteur de la construction, responsable de 37% des émissions mondiales de CO2, se doit d’investir dans la décarbonation, de nombreuses start-up françaises se concentrent sur le développement de nouveaux matériaux bas carbone, biosourcés, issus du biomimétisme ou des laboratoires. La dernière promotion de l’incubateur Leonard du groupe Vinci intègre d’ailleurs plusieurs sociétés spécialisées dans ce domaine, comme Materrup (béton bas carbone) ou Strong by Form (bois). L’essor de ces start-up est également encouragé par deux réglementations : d’un côté, la RER2020, qui impose des normes sur la réduction de CO2 dans les nouvelles constructions ; de l’autre, le « décret tertiaire », qui inclut des obligations de réduction de la consommation d’énergie dans les bâtiments du secteur. Toutefois, les sociétés spécialisées dans les matériaux bas carbone rencontrent des difficultés, dont des délais de contractualisation élevés, des certifications coûteuses et longues à obtenir, et la méfiance des entreprises du bâtiment, qui hésitent à adopter des nouveaux matériaux. De plus, le bâtiment traverse en ce moment une période difficile, en raison de l’augmentation des prix des matières premières et de la chute des projets de construction. Néanmoins, Benoît Lagente, directeur d’investissement à la Banque des Territoires, au capital de Wall’Up (béton de chanvre, bois) et ielo (paille), se veut optimiste. « Même si le marché est en baisse, les nouvelles constructions doivent respecter des normes réglementaires. De plus en plus d’acteurs vont devoir faire appel à des matériaux biosourcés », explique-t-il. Source : Les Echos |