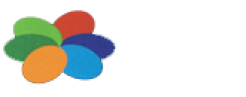L’actualité de la semaine: Cette semaine, Euractiv.fr se fait l’écho de la conviction exprimée par Martin Brudermüller selon laquelle la part de l’industrie, et plus particulièrement des industries à forte intensité énergétique comme l’industrie chimique, est appelée à diminuer dans le PIB des pays membres de l’Union européenne : fort de ce constat, le PDG de BASF appelle à “faire face” à ce “développement structurel”, notamment en réduisant les coûts. Comme le rapporte La Croix, la métropole de Lyon et la ville de Grenoble ont lancé des procédures judiciaires visant à faire reconnaître la responsabilité d’industriels comme Arkema et Daikin dans la pollution aux PFAS touchant certains cours d’eau. Qu’il s’agisse d’obtenir une réparation financière ou d’éviter les tensions sur l’approvisionnement en eau potable, le message envoyé aux industriels est clair : le temps de l’impunité est révolu. Comme l’indique Les Echos, les ministres de la Transition énergétique et de l’Industrie ont dévoilé une liste de 50 industriels qui, dans le cadre du Plan eau, s’engagent à réduire leur consommation en eau : cette mobilisation, particulièrement sensible dans le secteur de la chimie et de l’agroalimentaire, doit permettre de réduire de 10% les prélèvements en eau d’ici 2030. Dans les colonnes du Figaro, Corinne Le Quéré se félicite pour se part de la baisse de 4,8% des émission de CO2 observée en France au cours de l’année 2023 : elle appelle le gouvernement à poursuivre ses efforts afin d'”atteindre trajectoire conforme aux objectifs européens”. Le Monde revient enfin sur la baisse record (-10,1%) des émissions de gaz à effet de serre observée l’an dernier en Allemagne, une diminution principalement liée à une importante chute de la production. A condition de rester à la pointe de la technologie, l’industrie germanique peut toutefois continuer à tirer son épingle du jeu en se concentrant sur les spécialités à haute valeur ajoutée. Dans la presse cette semaine MARTIN BRUDERMÜLLER Pour le PDG de BASF, le déclin industriel de l’Union européenne s’annonce inéluctable S’exprimant à la sortie d’une Table ronde européenne de l’industrie qui s’est déroulée à Bruxelles le 18 mars dernier, Martin Brudermüller, PDG de BASF, a fait part à des journalistes de sa conviction selon laquelle les industries européennes à forte intensité énergétique continueront probablement de faire « particulièrement » les frais des coûts énergétiques maintenus à un niveau élevé. Réfutant le terme de « désindustrialisation » – « Je dirais que le mot “désindustrialisation” est très dur parce qu’il donne l’impression que tout disparaît » – celui qui doit céder le mois prochain les rênes du plus grand groupe chimique mondial, qu’il dirige depuis six ans, préfère analyser la situation comme un « développement structurel ». Il affirme sans ambages : « ce que nous constaterons assurément, c’est que la part de l’industrie contribuant au PIB va très probablement diminuer. » Et de renchérir : « c’est particulièrement vrai pour les industries à forte intensité énergétique, et l’industrie chimique en fait partie, tout comme le ciment, l’acier et bien d’autres encore. » En écho à l’injonction faite en février dernier par la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, de « réorganiser » le modèle économique d’outre-Rhin fondé sur l’industrie manufacturière, Martin Brudermüller a concédé que l’Allemagne « sera moins attractive pour les industries à forte intensité énergétique ». « C’est pour cette raison que la part de l’énergie diminuera. Cela ne veut pas dire que tout va disparaître. Mais oui, il est très probable que cette industrie choisisse de ne plus s’implanter en Allemagne. Nous devons faire face à cette situation », a-t-il abondé. Pour autant, le PDG de BASF appelle à ne pas entraver la libre concurrence sur le continent européen et à laisser « la magie bien réelle de la main invisible » opérer. Il a ainsi exprimé ses inquiétudes : « je suis très préoccupé par le fait que l’instinct politique à Bruxelles et dans la plupart des capitales soit toujours de parvenir au changement par le biais de réglementations prescriptives. » Du côté des institutions européennes, à l’instar de Tobias Gehrke, chargé de mission au Conseil européen des relations étrangères, on déclare pourtant : « la désindustrialisation est un danger clair et présent, en particulier pour les secteurs à forte intensité énergétique qui sont vitaux pour les écosystèmes en aval. » C’est peu dire qu’on voit d’un mauvais œil la décision de BASF de construire usine pétrochimique d’une valeur de 10 milliards d’euros àZhanjiang, dans le sud-est de la Chine, soit le plus important investissement jamais réalisé par l’entreprise vieille de 158 ans ! Un projet en totale contradiction avec la politique officielle de « réduction des risques » défendue par l’Union européenne. Martin Brudermüller campe néanmoins sur ses positions : « BASF est très dépendante du reste du monde, mais perd de l’argent en Allemagne. Nous devons restructurer partiellement cette activité. Nous devons réduire les coûts. Nous devons fermer les usines qui consomment beaucoup d’énergie et ne sont plus compétitives. » Il faut dire que la conjoncture lui donne raison : alors que son pays révisait ses prévisions de croissance pour 2024 de 1,3% à 0,2%, le ministre allemand de l’Économie, Robert Habeck, a récemment qualifié la situation de « dramatiquement mauvaise ». Si la Commission européenne prévoit à l’échelle de la zone euro une croissance de 0,8% en 2024, la Banque centrale européenne ne table plus de son côté que sur 0,6%. Dans ce contexte, la part de l’industrie dans le PIB de l’UE a vocation à continuer de décroître, ce alors que la Banque mondiale a déjà constaté que celle-ci s’était contractée de 28,8% en 1991 à 23,5% en 2022. Rapporté par euractiv.fr POLLUTION PFAS : Lyon et Grenoble poursuivent les industriels en justice La métropole de Lyon et la ville de Grenoble ont lancé des procédures judiciaires à l’encontre d’industriels qu’ils jugent responsables de la présence de per- et polyfluoroalkylés (PFAS) et d’autres produits chimiques sur leur territoire, notamment dans les cours d’eaux. Ces initiatives interviennent peu après la publication par l’Agence Régionale de Santé d’analyses révélant un taux de PFAS supérieur au seuil de référence européen dans les eaux destinées à la consommation de 166 000 habitants de la métropole lyonnaise. Les entreprises Arkema et Daikin sont directement mises en cause par Bruno Bernard, le président du Grand Lyon ayant déposé devant le tribunal judiciaire un « référé expertise » qui pourrait permettre à la collectivité de « faire évaluer scientifiquement et objectivement la responsabilité des deux industriels dans la pollution du réseau d’eau potable ». À Grenoble, la situation est rendue d’autant plus complexe qu’un arrêté préfectoral publié il y a plus de trente ans autorise des industriels, dont Arkema, à déverser leurs déchets dans la Romanche et le Drac, une décision que la collectivité entend faire annuler. Pour lamétropole de Lyon, l’enjeu est de faire supporter aux industriels le coût des travaux que la collectivité est contrainte d’engager afin de rendre l’eau de nouveau conforme aux normes sanitaires : « Si la responsabilité des industriels est établie, nous demanderons réparation pour ce préjudice : ce n’est pas aux consommateurs, qui sont eux-mêmes exposés à un risque, d’amortir ces surcoûts ! », estime en effet Bruno Bernard. A Grenoble, Eric Piolle cherche principalement à éviter toute tension autour de l’approvisionnement en restaurant progressivement le bon état des nappes souterraines et des eaux superficielles afin de « remplir les piscines publiques, alimenter le maraîchage urbain ou encore rafraîchir la ville ». Les procédures lancées par ces deux grandes collectivités pourraient venir appuyer l’action lancée par des associations et des particuliers lyonnais contre Arkema, estime-t-on au cabinet Kaïzen : « C’est aussi un message envoyé aux industriels. Face à une problématique aussi sérieuse, on ne peut plus tolérer la moindre impunité », conclut l’avocate Noémie Pierre. Paru dans La Croix EAU Plan eau : le gouvernement dévoile une liste de 50 industriels s’engageant à réduire leurs prélèvements Un an après le lancement du plan eau, Christophe Béchu et Roland Lescure, respectivement ministres de la Transition écologique et de l’Industrie, ont dévoilé une liste de 50 sites industriels s’engageant à réduire leurs prélèvements en eau. Ces sites ont été sélectionnés selon trois critères : l’importance de leur consommation d’eau, leur localisation dans une zone de tension hydrique et leur potentiel d’économie en eau. Plus de 50% de ces installations appartiennent aux secteurs de la chimie et de l’agroalimentaire, notamment Danone, Bell, Coca-Cola et Solvay. Pris dans leur ensemble, ces 50 sites représentent un quart des prélèvements d’eau du secteur industriel. D’un coût évalué à 327 millions d’euros, leurs projets de sobriété hydrique pourraient générer une économie de 77 millions de mètres cubes d’eau, soit 12,6% des prélèvements de l’ensemble des sites engagés. A noter que les 28 sites appartenant aux secteurs de la chimie et de l’agroalimentaire représentent 87% des économies d’eau attendues. Pour rappel, le plan eau vise une réduction de 10% des prélèvements d’eau en France d’ici 2030. De son côté, l’Etat prévoit de s’engager davantage sur le plan de l’expertise et de l’accompagnement que sur le plan financier : « il y a un enjeu réputationnel pour ces sites qui s’engagent sur des objectifs d’économie d’eau. De son côté, l’Etat leur fait bénéficier d’un accompagnement personnalisé en fonction de leurs procédés industriels par les agences de l’eau. Cela peut passer par des études, des expertises, conduites par les agents de l’Etat », explique-t-on en effet au ministère de l’Industrie. Les actions mises en placedépendront fortement de la nature des activités et des procédés de fabricationpropres aux différents industriels : l’installation de station d’épuration est prévue par certains, quand d’autres envisagent la mise en place de systèmes de détection acoustique des fuites ou de stations de traitement biologique pour réutiliser les eaux usées. Analysé par Les Echos DÉCARBONATION La présidente du Haut Conseil pour le Climat réagit à la baisse de 2023 des émissions carbonées Dans un entretien accordé au quotidien Le Figaro, la présidente du Haut Conseil pour le Climat, Corinne Le Quéré, réagit à la baisse de 4,8% des émissions de CO2enregistrée en France sur l’année 2023. Elle salue d’emblée celle-ci comme une « très bonne nouvelle » qui « reflète des efforts du gouvernement en matière d’investissements et de sobriété énergétique ». Puis pose dans la foulée que cette performance doit maintenant être réitérée chaque année jusqu’en 2030 « pour atteindre une trajectoire conforme aux objectifs européens ». Si la présidente du Haut Conseil pour le Climat déplore « quelques reculs par rapport aux politiques climatiques », à l’image de la réduction des investissements pour la rénovation thermique des bâtiments, elle se félicite que la France fasse « partie du groupe de 18 pays qui font les efforts les plus importants, derrière le peloton de tête des pays scandinaves et de la Grande-Bretagne ». Au sujet des transports, « secteur le plus émetteur en France », Corinne Le Quéré rappelle que « les solutions pour décarboner les transports existent, notamment avec la voiture électrique et le ‘transfert modal’ », avant de « se féliciter du fait que la France fasse partie du groupe de pays qui a su décorréler sa croissance économique et ses émissions de gaz à effet de serre ». En conclusion, interrogée sur le possible retour en arrière que pourrait générer le retour de Donald Trump à la Maison Blanche, la spécialiste du climat estime que la tendance à l’électrification des transports observée outre-Atlantique sera « difficile à enrayer ». Propos recueillis par Le Figaro ÉMISSIONS GES ALLEMANDES L’Office fédéral allemand de l’environnement enregistre la plus forte contraction des émissions carbonées depuis 1990 Avec une diminution de 10,1% en 2023 des émissions allemandes de gaz à effet de serre (GES) par rapport à 2022, c’est la meilleure performance en la matière depuis 1990 qu’a enregistrée l’Office fédéral allemand de l’environnement (UBA). Annoncée le 15 mars, cette baisse, qui devrait permettre à l’Allemagne de tenir ses objectifs climatiques établis à l’horizon 2030, pose néanmoins question. Est-elle pérenne carstructurelle ou consécutive à la récession économique qu’a connue le pays l’année dernière, avec un PIB qui s’est réduit de 0,3% ? Si le ministre de l’Économie et du climat, l’écologiste Robert Habeck, s’est targué d’un retour « sur la bonne trajectoire » de son pays, Viviane Raddatz, de l’association WWF Allemagne, fait montre de bien davantage de circonspection : « tout enthousiasme sur le recul des émissions reste en travers de la gorge quand on en examine les causes : ce sont les crises politique et économique, et non la volonté de transformation et de mesures structurelles de protection du climat, qui ont été à l’œuvre. » L’UBA concède : « leprincipal moteur de cette tendance est l’évolution conjoncturelle négative et l’augmentation des coûts, qui ont entraîné un déclin de la production. » Mais elle met néanmoins en exergue le rôle prépondérant joué par la production énergétique, dont les émissions ont chuté de 20,1%, les ramenant au niveau observé pendant la crise du coronavirus de 2020. Une diminution d’origine multifactorielle : baisse de la consommation due aux tarifs élevés, douceur hivernale, hausse des importations, mais surtout un recours amoindri aux énergies fossiles. Andreas Löschel, professeur en économie de l’environnement et des ressources à l’université de Bochum, salue : «beaucoup de centrales à charbon avaient été remises sur le marché en raison de la situation d’urgence, mais elles ont été finalement peu utilisées et disparaissent en ce moment du marché. C’est la plus grande transformation qu’on observe actuellement. » Prolongeant son analyse, l’universitaire affirme au sujet du modèle de production allemand : « on observe un changement structurel dans l’industrie, qui se concentre sur les productions les plus rentables : la production industrielle a certes baissé en volume, mais la valeur ajoutée se maintient à un niveau relativement stable, malgré la diminution des émissions. Le pays a tendance à abandonner la production de masse pour se concentrer sur les spécialités à haute valeur ajoutée, vendues donc plus cher. Cela vaut aussi pour la chimie : une partie de la chimie de base va se déplacer dans les pays où l’énergie, notamment renouvelable, est moins chère. Mais cela signifie aussi que l’Allemagne peut tout à fait réussir à se décarboner tout en restant un grand pays industriel… Si elle parvient à rester à la pointe technologique. » Publié par Le Monde