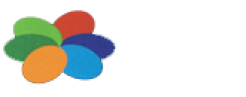| L’actualité de la semaine: |
| Cette semaine, usinenouvelle.com évoque l’inauguration par B+T de la première centrale de production d’énergie à partir de combustibles solides de récupération sur le territoire hexagonal. Construite sur la plateforme chimique de Chalampé dans le Haut-Rhin, cette installation permettra de pourvoir partiellement aux besoins énergétiques des usines d’Alsachimie, de Butachimie et de Linde. Le Monde consacre pour sa part un article aux difficultés rencontrées par l’Europe sur le chemin de la réindustralisation, les pays membres devant parvenir à surmonter les contradictions entre leurs ambitions écologiques et la réalité des besoins industriels. Les Echos s’intéresse de son côté au Salon automobile de Pékin, un événement mettant en évidence l’importance croissante de la Chine sur un marché qui était encore récemment la chasse gardée des constructeurs occidentaux. Dans une interview accordée au quotidien, Roland Lescure évoque les raisons du lancement d’un appel à manifestation d’intérêt pour le stockage du CO2 : “selon nos premières estimations, nous pourrions stocker au moins 800 mégatonnes de CO2 dans le sous-sol national, c’est-à-dire 50 ans des besoins de stockage carbone de notre industrie”, s’enthousiasme le ministre de l’Industrie et de l’Énergie. Enfin, Le Figaro évoque les difficultés rencontrées par les 174 pays participant à la quatrième session de négociations internationales sur la réduction de la pollution plastique qui se déroule actuellement à Ottawa. La position de la « Coalition de la haute ambition pour mettre fin à la pollution plastique », à laquelle appartient l’Union européenne, semble en effet difficilement conciliable avec celle de la Russie, de la Chine ou encore de l’Iran, autant de pays refusant toute baisse quantifiée de la production de plastique. L’enjeu est d’autant plus crucial que les plastiques pourraient représenter 15% des émissions de gaz à effet de serre à compter de 2060. |
| Dans la presse cette semaine |
| PRODUCTION D’ENERGIE |
| Combustibles solide de récupération : B+T inaugure la centrale de Chalampé Le 26 avril, l’entreprise B+T a inauguré sa première centrale de production d’énergie à partir de combustibles solides de récupération (CSR) en France, à Chalampé dans le Haut-Rhin. « C’est la première centrale de capacité industrielle mise en service en France », rappelle Marie-Hélène Schneider, directrice générale de B+T environnement SAS. La centrale, qui peut produire jusqu’à 80 MWh thermique par heure en brûlant 25 tonnes de déchets, a été construite sur le site d’Alsachimie, le fabricant de sel de nylon utilisant directement cette énergie pour remplacer jusqu’à 40 % de sa consommation de gaz naturel. Alsachimie redistribue également une partie de l’énergie à ses voisins, Butachimie et Linde. Environ la moitié des CSR provient d’un site de transformation de déchets industriels situé à une vingtaine de kilomètres de Chalampé. L’autre moitié est issue de déchets d’activités économiques. Les fumées de l’incinération sont quant à elles traitées pour éliminer les métaux lourds, les dioxines et les acides. B+T, qui exploite déjà quatre centrales similaires en Allemagne, a investi 130 millions d’euros dans le site de Chalampé. L’entreprise espère que cette vitrine lui permettra de convaincre d’autres clients en France d’investir dans des installations comparables. Analysé par usinenouvelle.com |
| POLITIQUE INDUSTRIELLE EUROPÉENNE |
| En perte de compétitivité, l’Europe face au défi de sa réindustrialisation Dans un contexte de mutations économiques et technologiques majeures, l’Europe doit relever le défi de la réindustrialisation pour maintenir sa compétitivité sur l’échiquier global. Pourtant, le chemin semble jonché d’obstacles, notamment réglementaires et économiques, rendant la tâche herculéenne. L’histoire du “vapocraqueur” envisagé par Ineos à Anvers symbolise les tiraillements auxquels l’industrie lourde européenne doit faire face. Les tribulations administratives et juridiques autour de l’approbation du projet, malgré son importance stratégique pour la production d’éthylène en Europe, montrent les défis de la politique environnementale et de développement durable auxquels l’Europe est confrontée. La décision initiale d’un juge de refuser l’autorisation du projet, en raison des préoccupations pour l’environnement, bien que finalement renversée après de coûteuses révisions, met en lumière la complexité des enjeux industriels face aux impératifs écologiques. Le cas de BASF, géant de la chimie allemande, illustre d’autant plus ce dilemme. L’annonce par Martin Brudermüller, directeur général de BASF, d’une préférence pour des investissements hors d’Europe, essentiellement aux États-Unis et en Chine, témoigne du découragement des industriels face aux coûts énergétiques élevés et à un environnement réglementaire contraignant. Cela trahit une désindustrialisation plus large au sein de l’UE, renforcée par des choix économiques et politiques antérieurs minimisant l’importance d’une politique industrielle volontariste. Cependant, un revirement de perspective s’amorce. Sous l’impulsion de crises récentes, telle la pandémie de Covid-19 et le conflit ukrainien, ainsi que la pression concurrentielle des États-Unis avec l’Inflation Reduction Act, l’UE commence à embrasser plus résolument la notion d’une politique industrielle proactive. La signature par Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, d’une déclaration pour un “deal industriel européen” marque une prise de conscience de la nécessité de renforcer le secteur industriel européen, face à l’urgence des transitions écologique et numérique. Malgré ces avancées, le chemin reste semé d’embûches. Des questions demeurent sur la cohérence et l’efficacité des initiatives européennes pour contrecarrer le phénomène de délocalisation industrielle et répondre adéquatement aux ambitions déclarées. Les contradictions entre des ambitions écologiques élevées, telles que celles du pacte vert européen, et la réalité des besoins industriels, en particulier dans des secteurs gourmands en énergie, restent à harmoniser. L’urgence d’une action coordonnée et puissante se fait sentir pour prévenir un décrochage industriel et technologique de l’Europe. Cela nécessite non seulement un engagement financier accru, mais également une refonte des cadres réglementaires pour favoriser une réindustrialisation qui soit à la fois compétitive et durable, garantissant ainsi la souveraineté économique et technologique européenne dans un monde de plus en plus polarisé. Analysé par Le Monde |
| SALON AUTOMOBILE DE PÉKIN |
| L’éclatant succès des constructeurs automobiles chinois s’illustre dans un évènement démesuré C’est en grande pompe que le Salon automobile de Pékin a ouvert ses portes le 25 avril dernier. Avec la présence notable du président Xi Jinping et la participation de 1.500 exposants sur une superficie de 320.000 mètres carrés, cet événement démontre une fois de plus le dynamisme et l’ambition de la Chine dans ce secteur. Jadis domaine exclusif des constructeurs occidentaux, la Chine s’est métamorphosée en un acteur prédominant du marché automobile mondial, brisant des records en tant que premier marché avec 21,7 millions de voitures vendues en 2023, ainsi que premier producteur et exportateur mondial. Le Salon, dans cette édition, reflète cette transformation avec un nombre vertigineux de véhicules, principalement des modèles de luxe et des SUVs, ainsi que des nouveautés telles que la Seagull jaune citron du groupe BYD et la SU7 de Xiaomi, ce dernier ayant récemment élargi son portefeuille industriel au secteur automobile. L’afflux massif vers les stands des marques locales, dominant le segment des véhicules électriques, illustre la prépondérance croissante des constructeurs chinois. L’innovation reste un moteur clé : les organisateurs ont enregistré la présentation de pas moins de 117 nouveaux modèles. Cette course à l’innovation est dictée par une clientèle chinoise peu fidèle aux marques, nécessitant un renouvellement constant des gammes pour rester compétitif. Ce Salon confirme également le recul des marques occidentales, à l’instar de Tesla qui n’est pas présent sur le Salon faute de nouveautés à présenter. Notons néanmoins l’exception notable de Volkswagen dont la Chine est plus que jamais le premier marché et qui présente avec ses coentreprises et partenaires locaux plus de quarante modèles. Côté français, Valeo se distingue comme le seul exposant tricolore. Témoignant de l’importance stratégique du marché chinois, les personnalités du monde de l’automobile, telles que le dirigeant de Renault, Luca de Meo, sont présentes pour observer et potentiellement forger des alliances, essentielles dans ce marché où l’innovation et la rapidité d’exécution dictent les règles du jeu. Relaté par Les Echos |
| PLANIFICATION ÉCOLOGIQUE |
| Lancement en France d’un appel à manifestation d’intérêt pour le stockage du CO2 À l’occasion du lancement d’un appel à manifestation d’intérêt pour des projets de capture du carbone sur le territoire hexagonal, le ministre de l’Industrie et de l’Énergie, Roland Lescure, livre une interview dans les Echos afin d’expliciter la méthode gouvernementale. Il commence par rappeler l’objectif ambitieux fixé par le président Emmanuel Macron début 2023 aux 50 sites tricolores les plus émetteurs : « diviser par deux leurs émissions de CO2 en dix ans, et établir avec l’Etat des feuilles de route de décarbonation ». 37 de ces 50 sites ont évalué que la tenue de ce calendrier imposerait de « capter et de stocker leur carbone résiduel, c’est-à-dire les émissions qui ne peuvent être évitées par le recours à d’autres technologies ». La chimie et les cimenteries sont particulièrement concernées. Quelque 8 millions de tonnes doivent être stockées à l’horizon 2030. Pionnière, la Norvège devrait commencer à stocker du carbone dès cette année. Pour le ministre de l’Industrie, « nous pouvons le faire aussi en France grâce à nos anciens gisements de pétrole et de gaz. L’idée, c’est de renvoyer le pétrole d’où il vient. » Il s’enthousiasme : « selon nos premières estimations, nous pourrions stocker au moins 800 mégatonnes de CO2 dans le sous-sol national, c’est-à-dire 50 ans des besoins de stockage carbone de notre industrie ! » C’est donc en ce sens qu’était lancé le 26 avril dernier un appel à manifestation d’intérêt pour le stockage en France. Deux jours plus tôt était présenté au Parlement un projet de loi de simplification en vue de la facilitation de la conversion de puits d’hydrocarbures en puits de stockage du carbone. Voyant dans les régions concernées des opportunités de reconversion pour les habitants qui travaillent dans l’industrie du sous-sol, Roland Lescure scande : « la transition écologique, c’est aussi une manière de créer des emplois et de la prospérité. » Interrogé sur le fait que le captage et le stockage du carbone soit perçu par les pays pétroliers comme un moyen de ralentir la transition en repoussant la fin des hydrocarbures, le ministre de l’Industrie et de l’Énergie oppose que « le captage, c’est ce qu’il reste quand on a tout essayé ». Il « n’arrive qu’en dernier recours, pour le CO2 résiduel quand il n’y a pas d’autres solutions économiquement viables », poursuit Roland Lescure, avant de faire part en conclusion de son espoir que « certains se diront que cela rapportera plus de stocker du carbone que d’exploiter du pétrole. » Propos recueillis par Les Echos |
| POLLUTION PLASTIQUE |
| Traité sur la pollution plastique : les Etats peinent à trouver un compromis Les 174 pays participant à la quatrième session de négociations internationales sur la réduction de la pollution plastique, qui se déroule à Ottawa entre le 23 et le 29 avril, peinent à trouver un accord sur ce sujet épineux. D’un côté, la « Coalition de la haute ambition pour mettre fin à la pollution plastique », dont l’Union européenne et la France font partie, vise une baisse de la production de plastique à partir de 2040 et préconise la notion de « pollueur payeur » ainsi que l’interdiction des produits les plus dangereux. De l’autre, un autre groupe de pays, tels que l’Arabie saoudite, l’Iran, la Russie et la Chine, refusent tout objectif ambitieux et prônent une « économie circulaire du pastique », sans baisse quantifiée de la production. Alors que les négociations pour arracher un compromis continuent, les représentants des pays doivent rédiger une « version zéro » du texte, qui devrait être approuvée d’ici fin 2024 lors d’une cinquième réunion. Le document final devrait être signé par les représentants des pays en 2025. Toutefois, compte tenu du contexte géopolitique tendu, qui risque de « parasiter » les pourparlers, la France et d’autres pays souhaitent la poursuite des négociations après la fin du sommet d’Ottawa et avant celui de Busan, prévu le 25 novembre. D’après Henri Bourgeois Costa, directeur de la mission économie circulaire à la Fondation Tara Ocean, un objectif « ambitieux » serait une « diminution de 50% de la production par rapport au niveau de 2019 ». Pour rappel, la demande augmentant, les plastiques pourraient représenter 15% des émissions de gaz à effet de serre vers 2060, contre 3,4% aujourd’hui, et posent déjà des risques majeurs pour l’environnement et la santé. Rapporté par Le Figaro |