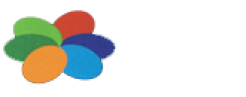| La publication périodique spécialisée Chimie Pharma Hebdo met cette semaine à l’honneur la division Performance Materials de BASF, laquelle s’est engagée dans le cadre de sa stratégie #OurPlasticsJourney à approvisionner l’ensemble de ses sites européens exclusivement en énergies renouvelables. Dans les colonnes des Echos, sont décryptées les entraves à la compétitivité de la chimie européenne consécutives à l’application de la réglementation Reach, en vigueur depuis 2007. Un collectif de scientifiques, sous la houlette de Xenia Trier, chimiste de l’environnement à l’université de Copenhague, lance un appel aux industriels pour qu’ils leur fournissent des « standards de référence » afin de mieux détecter les polluants tels que les PFAS, relaie Le Monde. Alors que Donald Trump a brandi la menace d’augmentation des droits de douane pour les importations en provenance de l’Union Européenne, La Tribune livre un panorama des échanges commerciaux entre les Etats-Unis et l’UE afin de mesurer les potentielles répercussions. Enfin, Les Echos saluent les efforts consentis par Engie pour promouvoir les contrats d’électricité décarbonée à long terme : sur l’année 2024, pas moins de 85 Power Purchase Agreements (PPA) ont été signés par l’énergéticien tricolore avec des groupes tels que Meta, Sanofi, Amazon ou encore Carrefour. |
| Dans la presse cette semaine |
| |
| #OURPLASTICSJOURNEY |
| La division Performance Materials de BASF s’approvisionne désormais exclusivement en énergie verte « En tant que BASF, nous voulons permettre à nos clients de réaliser une transformation verte, et nous pensons que cela commence par nous. C’est notre ambition et l’objectif de #OurPlasticsJourney » : tels sont les propos tenus par Martin Jung, président de la division Performance Materials de BASF. Une déclaration qui intervient au moment où le géant allemand de la chimie s’engage résolument sur la voie de la durabilité en convertissant l’ensemble de ses sites européens de la division Performance Materials à l’électricité renouvelable. Cette transition concerne notamment les installations dédiées au compoundage de plastiques techniques, aux polyuréthanes et aux polymères spéciaux. Au total, neuf sites ont été transformés dès le début de l’année, marquant ainsi une étape significative vers l’objectif ambitieux de BASF de réduire de 25 % ses émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030, par rapport à 2018, et d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050. L’initiative de BASF ne se limite pas à l’Europe. Le groupe prévoit d’étendre cette conversion à l’échelle mondiale, en participant à des projets d’envergure pour augmenter la production d’énergie renouvelable. Parmi ces projets figure le plus grand parc éolien offshore au monde, situé en mer du Nord, qui a débuté ses opérations en 2023. Ce parc, en partenariat avec Vattenfall, alimente déjà plusieurs sites européens. De plus, le site allemand de Schwarzheide intègre une capacité de 24 mégawatts d’énergie solaire. Cependant, l’électricité renouvelable n’est qu’un aspect de cette transformation. BASF mise également sur la vapeur verte, produite par l’électrification des procédés, et sur l’utilisation de matières premières alternatives via l’approche du bilan massique. Ces initiatives s’inscrivent dans une stratégie globale visant à promouvoir une économie circulaire et à optimiser les processus de production, illustrant ainsi l’engagement de BASF pour une industrie chimique durable. Mis à l’honneur par Chimie Pharma Hebdo |
| REGLEMENT REACH |
| La compétitivité de la chimie européenne entravée par la règlementation en vigueur depuis 2007La prise de conscience croissante concernant la compétitivité déclinante de l’industrie européenne ravive des débats sur des régulations préexistantes, notamment le règlement Reach, instauré en 2007 pour encadrer l’industrie chimique. Initialement conçu pour protéger les consommateurs en améliorant l’information sur les produits chimiques, ce dispositif est aujourd’hui critiqué pour sa lourdeur. La Commission européenne, après maints reports, a annoncé une révision imminente de cette réglementation, dans le but de stimuler la compétitivité du secteur tout en préservant les normes de sécurité. La révision proposée vise à alléger les obligations déclaratives, avec une réduction de 25 % pour les grandes entreprises et 35 % pour les PME, sans compromettre la sécurité, une préoccupation soulevée par les organisations environnementales. Actuellement, toutes les entreprises opérant dans l’espace économique européen doivent déclarer et enregistrer les substances chimiques utilisées ou produites au-delà d’une tonne par an. Ce processus concerne principalement l’industrie chimique, mais s’étend également à d’autres secteurs tels que l’aviation et la pharmacie. Sur les 130.000 substances chimiques connues, 36.000 sont enregistrées sous Reach. Pour les substances jugées préoccupantes, une autorisation est requise, et leur utilisation peut être restreinte ou interdite si le risque est inacceptable. Une évaluation socio-économique est effectuée pour estimer l’impact de telles interdictions. Le coût de Reach, évalué à 5 milliards d’euros, bien qu’inférieur aux prévisions initiales, reste substantiel. Les industriels déplorent la lenteur des processus, freinant l’introduction de nouvelles molécules plus écologiques. Ils appellent également à un renforcement des contrôles sur les importations pour éviter les distorsions de concurrence. La révision pourrait inclure une prise en charge partielle des coûts par l’Europe, une proposition antérieurement discutée. Décrypté par Les Echos |
| PFAS |
| L’appel des scientifiques aux industriels pour qu’ils leur fournissent des « standards de référence » afin de mieux détecter les polluants La détection des polluants environnementaux, tels que les PFAS, repose sur l’utilisation de standards de référence, essentiels pour calibrer les instruments d’analyse et évaluer la toxicité de ces substances. Cependant, l’accès à ces étalons est entravé par des restrictions industrielles, invoquant le secret commercial et la protection des brevets. Cette situation limite la capacité des scientifiques à fournir des preuves indépendantes nécessaires à la gestion des risques chimiques, compromettant ainsi la protection de l’environnement et de la santé publique. Les scientifiques, sous la direction de Xenia Trier, chimiste de l’environnement à l’université de Copenhague, soulignent que l’absence de réglementation obligeant les industriels à fournir ces standards pour les 350 000 produits chimiques enregistrés mondialement, y compris les PFAS, est problématique. Actuellement, seuls environ 6 % des PFAS disposent de ces étalons, ce qui limite l’efficacité des réglementations. La pratique de « substitution regrettable » par l’industrie, remplaçant les PFAS interdits par d’autres composés tout aussi nocifs, aggrave la situation. Le cas du C604, un substitut au PFOA développé par Syensqo, illustre cette problématique. La société a restreint la distribution de son standard de référence, invoquant des violations de brevets, et limite son utilisation à des fins spécifiques, entravant ainsi la recherche indépendante. Pour remédier à cette faille, les scientifiques proposent que les producteurs soient contraints de fournir des standards de référence à une banque publique avant la mise sur le marché de leurs produits. Cette mesure pourrait être intégrée dans la révision du règlement européen Reach, renforçant ainsi la transparence et la sécurité environnementale. Les auteurs insistent sur la nécessité d’exempter les services publics de santé et environnementaux des restrictions actuelles pour garantir une protection efficace contre la pollution chimique. Relayé par Le Monde |
| PROTECTIONNISME AMÉRICAIN |
Droits de douane annoncés par Donald Trump : quelles répercussions pour l’Europe ?Dans un contexte de tensions commerciales, le président américain Donald Trump a exprimé son intention d’imposer des droits de douane à l’Union européenne, dénonçant un traitement inéquitable. Cette déclaration s’inscrit dans un cadre d’échanges commerciaux complexes entre les États-Unis et l’UE, caractérisés par un excédent européen en matière de biens et un avantage américain dans le secteur des services. En 2023, les exportations de biens de l’UE vers les États-Unis ont atteint 503,8 milliards d’euros, contre 347,1 milliards d’euros d’importations, soit un excédent de 157 milliards d’euros pour l’Union. Les États-Unis demeurent le principal client des biens européens, représentant 20 % des exportations totales de l’UE. L’Allemagne, grâce à son industrie automobile et chimique, ainsi que l’Italie et l’Irlande, figurent parmi les principaux bénéficiaires de cet excédent. Cependant, la balance des services présente un tableau différent, penchant nettement en faveur des États-Unis, avec un déficit européen de 104 milliards d’euros en 2023. Ce déséquilibre est accentué par la présence en Irlande de sièges européens de géants numériques américains, tels qu’Apple et Google, qui génèrent d’importants flux financiers vers les États-Unis. Les échanges de services entre les deux régions ont connu une croissance notable, les importations de services de l’UE en provenance des États-Unis passant de 24,6 % à 34,3 % entre 2012 et 2022. Cette dynamique souligne la complexité des relations commerciales transatlantiques, marquées par des interdépendances et des déséquilibres sectoriels.
Analysé par La Tribune |
| ENGIE |
Énergie décarbonée : pas moins de 85 Power Purchase Agreements signés par Engie en 2024L’énergéticien français Engie a intensifié ses efforts pour promouvoir les contrats d’électricité décarbonée à long terme, signant 85 Power Purchase Agreements (PPA) pour 2024, représentant 4,6 GW d’énergie solaire et éolienne. Ces contrats visent à répondre aux besoins énergétiques des grandes entreprises, notamment dans le secteur technologique avec des clients comme Meta, et dans l’industrie avec Sanofi. Comparativement aux 2,7 GW sécurisés en 2023, cette avancée souligne l’essor croissant des PPA, un marché ayant doublé en quatre ans. Les énergies renouvelables émergent comme des solutions économiquement viables face aux fluctuations des prix de l’électricité, encore influencés par le cours du gaz. Les PPA s’avèrent être 10 à 15 % moins coûteux que les approvisionnements à court terme, tout en offrant une stabilité tarifaire sur une durée moyenne de onze ans. Ces accords permettent à Engie de sécuriser 136 tWh d’électricité annuelle pour ses clients, équivalant à un quart de la production électrique française. Engie, en pleine expansion, voit dans les PPA un vecteur de croissance crucial, optimisant ses investissements dans les centrales renouvelables. Avec un portefeuille de 14 GW de contrats, Engie ambitionne d’atteindre 80 GW de capacités renouvelables d’ici 2030. L’entreprise diversifie ses engagements géographiquement, signant des contrats aux États-Unis, en Europe, en Amérique du Sud et en Asie, malgré les incertitudes politiques, notamment aux États-Unis. Des géants comme Amazon et Carrefour ont également rejoint la liste des clients d’Engie, soulignant l’attrait croissant pour l’énergie verte.
Rapporté par Les Echos |