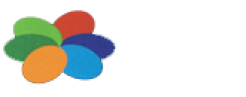| L’actualité de la semaine: |
|
| Alors que les plans de restructuration s’amoncellent dans la chimie allemande, Les Echos analysent cette semaine la véritable révolution paradigmatique à l’œuvre dans le secteur. Toujours dans Les Echos, on rend compte de l’adoption par le Parlement européen, le 27 février dernier, d’un texte interdisant les exportations de déchets plastiques vers des pays non-membres de l’OCDE. Le 29 février, lors de la présentation des résultats de son groupe, Thierry Le Hénaff, le PDG d’Arkéma, a fait montre de prudence et de retenue, nous rapporte encore le quotidien économique de référence. Dans un entretien accordé à La Croix, la journaliste Célia Izoard nous explique en quoi l’essor du numérique se révèle à ses yeux rigoureusement incompatible avec la transition écologique qui s’impose. Enfin, les derniers chiffres de l’Agence Internationale de l’Energie, lesquels font état d’un niveau record des émissions carbonées atteint par le secteur énergétique en 2023, nous sont relayés par Le Figaro. |
| Dans la presse cette semaine |
| CHIMIE ALLEMANDE |
| Les restructurations dans l’industrie chimique s‘enchaînent en Allemagne et remodèlent le secteur « Ce que nous vivons actuellement n’est pas une fluctuation conjoncturelle, mais unchangement massif de notre environnement économique » : tenus par Christian Kullmann, PDG du numéro deux de la chimie allemande, Evonik, ces propos donnent la mesure des défis auxquels font aujourd’hui face les industriels outre-Rhin. Plongé dans une crise structurelle, le secteur voit les annonces de plans de restructurations’enchaîner. Après BASF, qui a d’ores et déjà annoncé quelque 2600 suppressions de postes, principalement dans l’administration, ou le groupe pharma-chimique Bayer, dont le PDG, Bill Anderson, devait présenter ce 5 mars un plan de redressement alors qu’il a déjà annoncé une contraction des niveaux hiérarchiques dans l’entreprise, c’est au tour d’Evonik d’officialiser la suppression de 2000 postes à travers le monde, dont les deux tiers en Allemagne. Une fois encore, ce sont principalement les postes d’encadrement qui sont dans le collimateur : dénonçant des processus de décision « beaucoup trop complexes et trop chers », Christian Kullmann prévoit de réduire à six la dizaine de niveaux hiérarchiques structurant les33 000 salariés du groupe. À la tête de Lanxess, le leader allemand des plastiques haute performance, Matthias Zachert a également pris l’engagement dans les colonnes du quotidien économique d’outre-Rhin Handelsblatt de « mettre les gaz » pour rendre en 2024 son entreprise « performante sur le plan opérationnel ». Concrètement, lescadres vont devoir opérer une mutation de leurs fonctions commerciales vers un statut d’expert technique. Ce dans un contexte marqué par la fin du modèle historique allemand des grandes structures intégrées. C’est ainsi une véritablerévolution paradigmatique qui est à l’œuvre dans la chimie allemande, ce que Christian Kullmann qualifie de « changement radical d’époque ». Analysé par Les Echos |
| DÉCHETS PLASTIQUES |
| L’interdiction d’exportation des déchets plastiques vers des pays non-membres de l’OCDE votée par le Parlement européen C’est à une écrasante majorité – 587 voix pour, 8 contre, et 33 abstentions – que leParlement européen a adopté le 27 février dernier un texte portant sur les transferts de déchets hors de l’Union européenne. Aux termes de cet accord, les exportations vers des pays non-membres de l’OCDE seront tout bonnement proscrites, à moins que ceux-ci ne disposent des installations nécessaires pour « les gérer de manière écologiquement rationnelle », lesquelles doivent avoir été certifiées par des « organismes indépendants ». Rapporteure du texte, la députée du PPE Pernille Weiss se félicite de conférer « aux Européens une plus grande certitude que leurs déchets seront gérés de manière appropriée, quel que soit l’endroit où ils sont expédiés. L’UE assumera enfin la responsabilité de ses déchets plastiques en interdisant ses exportations vers des pays non-membres de l’OCDE. » Sur l’année 2022, ce sont 32,1 millions de tonnes de déchets, essentiellement à destination de laTurquie (12,4 millions de tonnes), qui avaient été exportées. Alors que certains eurodéputés avaient pu mettre en garde contre une entorse pressentie aux règles de l’Organisation mondiale du commerce, les services juridiques du Parlement ont fait valoir que « l’introduction d’une interdiction, totale ou partielle et inconditionnelle, des exportations vers les pays tiers » pouvait être « justifiée par un motif d’ordre public »tel que la santé ou l’environnement. À travers ce texte, les eurodéputés ont adressé en filigrane aux producteurs européens de plastiques une invitation à mettre les bouchées doubles sur le recyclage et le réemploi. Un autre texte sur la réduction des déchets d’emballage doit d’ailleurs être débattu avant la fin de la mandature, la session parlementaire s’achevant mi-avril. Relayé par Les Echos |
| ARKÉMA |
| Le prudence prévaut lors de la présentation des résultats du chimiste Arkéma Le 29 février dernier, à l’occasion de la présentation des résultats annuels de son groupe, le PDG d’Arkéma, Thierry Le Hénaff, a fait montre de prudence et de retenue : « S’il y a un rebond, il sera progressif à partir du printemps. » Avant d’ajouter : « dans tous les cas, même s’il n’y a pas de reprise, nous serons en mesure de tenir nos objectifs, grâce à la transformation que nous avons opérée. » Pour cette année 2024, le groupe table aujourd’hui sur un Ebitda compris entre 1,5 et 1,7 milliard d’euros, après avoir réalisé 15,8% de marges en 2023, contre 18,3% l’année précédente. Du fait des déstockages auxquels ont procédé les clients qui avaient fait des stocks pendant la crise du Covid pour parer aux difficultés logistiques, la demande a fléchi, si bien qu’Arkema n’a réalisé que 9,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires l’année dernière, en recul de 16,1% à taux de change et périmètre constants. Uneamélioration a néanmoins pu être observée en fin d’année, que Thierry Le Hénaff salue de la sorte : « c’est le bénéfice du travail réalisé en interne et la comparaison avec le quatrième trimestre 2022, qui était plus normal que les précédents. » Aux dires du PDG, c’est outre-Atlantique que se trouve les principaux leviers de croissance du groupe, qui concentre 37% de son activité en Amérique du Nord (contre 34% pour l’Europe et 24% en Asie). Il explique que les 634 millions d’euros investis l’an dernier par Arkéma l’ont été à parts égales sur les trois zones mais précise : « nous réalisons nos investissements de croissance, avant tout, en Amérique du Nord et en Asie. En Europe, ce sont surtout des investissements dans la sécurité et l’environnement, pour nous adapter à la législation et parce que les usines sont plus anciennes. » Par ailleurs, le groupe chimique hexagonal envisage dès 2024 de tirer profit de son acquisition du spécialiste sud-coréen des polymères de très haute performance PIAM. D’autres acquisitions, mais de moindre importance, sont également à l’étude. Enfin, consécutivement aux vertes critiques dont Arkéma a fait l’objet de la part d’associations environnementales pour son utilisation d’un « additif fluoré »considéré par ces dernières comme un « polluant éternel », le groupe a annoncé y mettre un terme avant 2025. « Il fallait attendre l’homologation de ses remplaçantschez tous nos clients, mais ce sera fait fin 2024 », s’est engagé Thierry Le Hénaff. Présenté par Les Echos |
| TRANSITION ÉCOLOGIQUE |
La journaliste Célia Izoard dénonce l’impact environnemental du numérique Dans un entretien avec La Croix, la journaliste Célia Izoard, spécialiste des nouvelles technologies, explique que l’essor du numérique est incompatible avec la transition écologique, puisque ce secteur est très gourmand en métaux. Leur extraction massive, dont l’impact environnemental n’a pas encore été étudié, créerait « une dette écologique invraisemblable » à l’égard de nombreuses régions du monde. De plus, l’extraction entraîne souvent des violences, notamment vis-à-vis des peuples autochtones. « C’est extrêmement paradoxal : pour se débarrasser du papier, perçu comme trop encombrant et polluant, on a équipé tous les foyers occidentaux des machines les plus intensives en matières premières que l’humanité a jamais connues. Et encore aujourd’hui, on parle de « cloud » et de « dématérialisation » ! », souligne la journaliste. À son avis, il existe plusieurs solutions pour changer de trajectoire et respecter l’Accord de Paris, telles qu’obliger les administrations à conserver des alternatives au numérique, arrêter le déploiement des objets connectés ainsi que réduire le recours au streaming et à l’intelligence artificielle. Toutefois, contrairement aux associations, aucun parti politique ne soutient ces revendications pour l’instant.
Propos recueillis par La Croix |
| ENVIRONNEMENT |
Les émissions de CO2 générées par le secteur énergétique ont atteint un niveau record en 2023 Le 1er mars, l’Agence internationale de l’énergie (AIE) a révélé que les émissions mondiales de CO2 liées à l’énergie ont atteint un niveau record en 2023, en hausse de 1,1 %. Plusieurs facteurs expliquent cette augmentation. En premier lieu, un déclin significatif de la production hydroélectrique mondiale, dû aux sécheresses, a obligé les pays concernés (Chine, Canada, Mexique…), à se tourner vers d’autres moyens de production polluants, dont le fioul ou le charbon. En deuxième lieu, lacroissance économique de la Chine, « riche en émission », a continué après la crise sanitaire, ajoutant ainsi 565 millions de tonnes de CO2 au bilan mondial. En revanche, les économies avancées ont observé une baisse record de leurs émissions, malgré la progression de leur PIB. Les experts soulignent que les chiffres de 2023 « ne vont pas dans le bon sens », car les émissions de gaz à effet de serre, tous secteurs confondus, doivent diminuer de 43 % d’ici à 2030 par rapport à 2019, afin de respecter la limite de 1,5 °C fixée par l’Accord de Paris. Toutefois, l’AIE rappelle le rôle important joué par les énergies « propres », comme les renouvelables. En effet, ces dernières limitent « les émissions même avec une demande énergétique mondiale augmentant plus rapidement en 2023 qu’en 2022 », selon le directeur exécutif Fatih Birol.
Rapporté par Le Figaro |