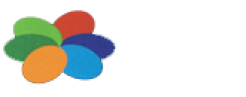| L’actualité de la semaine: |
| Le media en ligne agrodistribution.fr rend cette semaine compte de la conférence de presse annuelle de la division Agro de BASF France qui s’est tenue le 7 novembre dernier. Celle-ci a constitué l’occasion pour le directeur général, Jean-Jacques Pons, d’afficher de solides ambitions pour 2030, avec l’objectif de 59% d’innovations dans le portefeuille produits. Le site spécialisé à destination des professionnels des cosmétiques et des industries de beauté, premiumbeautynews.com, se fait quant à lui l’écho du partenariat noué par BASF avec le pionnier européen des biotechnologies, Acies Pro, pour innover dans la production d’alcools gras. Aux dires de Matthias Maase, directeur mondial de la durabilité pour les produits chimiques de soin chez BASF, cette collaboration profitera aux “clients des secteurs des cosmétiques, des produits ménagers et de l’industrie chimique et pharmaceutique, ainsi qu’aux formulateurs industriels du monde entier.” Dans les colonnes des Echos, il est question de la difficile constitution d’un modèle économique pour le recyclage des batteries en Europe, ce en dépit du fait que la “black mass” apparaisse aujourd’hui comme la solution stratégique pour sécuriser l’approvisionnement en métaux essentiels. Toujours dans le quotidien économique de référence, nous est livré un récit en six dates du processus d’éclatement de la coalition gouvernementale allemande, lequel a abouti le 6 novembre dernier au limogeage par le chancelier Olaf Scholz de son ministre libéral (FDP) des finances, Christian Lindner. Nonobstant le contexte d’incertitudes qui prévaut aujourd’hui, le secteur industriel tricolore est appelé à maintenir le cap de la baisse des émissions carbonées, peut-on encore lire dans Les Echos. Enfin, le même quotidien d’information économique et financière fondé en 1908 nous dévoile les enjeux de la COP29 qui s’est ouverte à Bakou, en Azerbaïdjan, avec notamment au menu des discussions la question cruciale de la définition d’un nouveau cadre financier, le “new collective quantified goal” (NCQG), pour soutenir les pays en développement dans leur transition écologique. |
| Dans la presse cette semaine |
| BASF FRANCE DIVISION AGRO |
| BASF poursuit sa transformation en « réinventant l’ensemble de son modèle de performance » Lors de sa conférence de presse annuelle, tenue le jeudi 7 novembre, BASF a exposé ses perspectives de développement et ses objectifs ambitieux pour 2030, notamment en termes d’innovation, qui devrait représenter 59 % de son portefeuille de produits. Jean-Jacques Pons, directeur général de la division Agro de BASF France, a articulé la stratégie de l’entreprise autour de trois axes principaux : l’innovation, la digitalisation et la décarbonation, lors d’une visioconférence. Avec un investissement de près de 900 millions d’euros en recherche et développement pour l’année 2023, BASF a introduit de nouvelles solutions agrochimiques, incluant des inhibiteurs d’uréase et des bistimulants, en collaboration avec Elicit Plant. La firme s’engage également dans le développement de biosolutions, allouant 13 % de son budget R&D en France à ce segment, avec l’objectif de devenir un leader du marché d’ici 2030. En outre, BASF prévoit de lancer divers produits entre 2025 et 2026, y compris des traitements pour les semences et contre l’oïdium sur la vigne et la pomme de terre. Des innovations en matière de blés hybrides sont également prévues pour 2028. Sur le plan numérique, BASF a renforcé son offre avec l’intégration de la betterave dans Xarvio Field Manager, permettant une gestion optimisée des traitements fongicides. L’acquisition de la société Horta en 2022 a enrichi ses outils d’aide à la décision avec Agrigenius, qui évalue les risques de maladies viticoles. Par ailleurs, BASF expérimente xarvio Healthy Fields, une approche service visant à garantir la santé des cultures. L’entreprise réitère son engagement envers la réduction de l’impact environnemental des produits phytosanitaires, en développant des outils comme Pratiqu’Eau-pratique et en déployant la technologie Easyconnect pour sécuriser l’utilisation des produits chimiques. En conclusion, BASF se positionne comme un acteur proactif dans la réinvention de l’agrochimie, en intégrant l’innovation, la technologie numérique et la responsabilité environnementale au cœur de sa stratégie pour les années à venir. Relayé par agrodistribution.fr |
| PARTENARIAT ACIES PRO |
| Cosmétiques : BASF noue un partenariat avec le leader des biotechnologies Acies Pro BASF, géant de la chimie, s’associe à Acies Bio, pionnier européen des biotechnologies, pour innover dans la production d’alcools gras via la fermentation de méthanol. Ces alcools gras, indispensables dans la fabrication de tensioactifs, sont couramment utilisés dans les industries des produits d’entretien et des soins personnels. Le projet s’appuie sur la plateforme OneCarbonBio d’Acies Bio, une technologie avant-gardiste conçue pour transformer le méthanol renouvelable, obtenu à partir de CO2 recyclé, en diverses matières premières. Cette initiative illustre un engagement profond envers la durabilité, visant à développer une méthode de production alternative et écologique pour répondre aux besoins des marchés cosmétiques et des produits ménagers. Acies Bio se chargera de sélectionner des microbes adaptés et d’optimiser le processus de fermentation, tandis que BASF contribuera par son expertise technique et son réseau commercial global. Matthias Maase, directeur mondial de la durabilité pour les produits chimiques de soin chez BASF, souligne l’importance de cette collaboration : “La biotechnologie complète notre chimie pour créer un avenir plus durable. Grâce à une approche collaborative et interdisciplinaire, notre champ de recherche dans le cadre de ce partenariat couvre l’ensemble de la chaîne, du développement des souches de production à la fabrication à grande échelle. Cela profitera à nos clients des secteurs des cosmétiques, des produits ménagers et de l’industrie chimique et pharmaceutique, ainsi qu’aux formulateurs industriels du monde entier.” Repéré par premiumbeautynews.com |
| BLACK MASS |
| La difficile constitution d’un modèle économique pour le recyclage des batteries En Europe, le secteur des véhicules électriques rencontre des difficultés notables pour s’implanter de manière pérenne et robuste. Les gigafactories, ces vastes usines dédiées à la production de batteries, font face à des retards et des révisions à la baisse de leurs capacités de production. Parallèlement, le secteur du recyclage des batteries, essentiel à la durabilité de l’industrie, est également impacté. Des projets significatifs, tels que celui d’Eramet à Dunkerque, ont été suspendus, reflétant une certaine prudence ou réticence des investisseurs. Cette situation précaire pourrait compromettre les ambitions de l’Union européenne de diminuer sa dépendance vis-à-vis de la Chine, qui domine largement le marché des métaux nécessaires à la fabrication des batteries, de l’extraction à la finition. Le recyclage, et notamment le traitement de la “black mass” – un résidu de la décomposition des batteries –, est perçu comme une solution stratégique pour sécuriser l’approvisionnement en métaux essentiels. Toutefois, le Centre d’études prospectives et d’informations internationales (Cepii) souligne que bien que le recyclage puisse diminuer la dépendance aux ressources minières, il requiert des investissements considérables en infrastructures et en technologies adaptatives. L’industrie fait face à un double défi : la fluctuation des volumes de déchets de batteries disponibles pour le recyclage, due au ralentissement des ventes de véhicules électriques, et l’incertitude quant à la chimie des batteries qui prévaudra à l’avenir. Cette incertitude influe directement sur la valeur économique du recyclage, les batteries au lithium fer phosphate (LFP), par exemple, contenant moins de métaux de valeur que celles au nickel cobalt manganèse (NMC). La classification de la “black mass” en tant que déchet dangereux pourrait empêcher son exportation hors de l’OCDE, favorisant ainsi le recyclage local et sécurisant l’approvisionnement. Cependant, une telle mesure pourrait également compliquer le transport de ces matériaux au sein même de l’Europe. La décision de l’Union européenne à ce sujet est très attendue et pourrait avoir des implications significatives pour l’avenir de l’industrie européenne des batteries. Analysé par Les Echos |
| COALITION GOUVERNEMENTALE ALLEMANDE |
| L’effondrement de la coalition d’Olaf Scholz outre-Rhin en six dates clés L’éclatement de la coalition gouvernementale en Allemagne, dirigée par Olaf Scholz, a été le résultat d’une série d’événements marquants qui ont exacerbé les tensions internes. Le 15 novembre 2023, la Cour constitutionnelle de Karlsruhe a rendu un arrêt crucial, jugeant que la coalition avait enfreint la règle du « frein à l’endettement ». Cette décision a plongé le gouvernement dans une crise budgétaire, remettant en cause l’utilisation des fonds spéciaux, qui étaient le ciment de l’alliance entre sociaux-démocrates, écologistes et libéraux. Le 1er septembre 2024, les élections régionales en Saxe et en Thuringe ont accentué la pression sur le parti libéral (FDP), qui a échoué à maintenir sa représentation, tandis que l’extrême droite progressait. Cette débâcle électorale a fragilisé la position de Christian Lindner, ministre des Finances, au sein de la coalition. Le 29 octobre 2024, un affrontement public entre Olaf Scholz et Christian Lindner a eu lieu, symbolisé par l’organisation de sommets économiques concurrents. Lindner a orchestré un « contre-sommet » pour exprimer son désaccord avec les orientations du chancelier, exacerbant les tensions. Le 1er novembre 2024, un manifeste de Christian Lindner, intitulé « Tournant économique pour l’Allemagne », a circulé, proposant des révisions politiques radicales. Ce document, perçu comme une lettre de divorce, a été rejeté par le SPD et les Verts, aggravant la crise. Le 4 novembre 2024, malgré des tentatives de conciliation, les divergences ont persisté, notamment sur l’utilisation des fonds pour combler le déficit budgétaire. Le FDP a refusé de céder sur la règle du frein à l’endettement, soulignant l’importance des réformes structurelles. Enfin, le 6 novembre 2024, jour de la réélection de Donald Trump, Olaf Scholz a limogé Christian Lindner, marquant la fin de la coalition. Ce geste, motivé par l’incapacité à surmonter les divergences, a ouvert la voie à des élections anticipées, plongeant l’Allemagne dans l’incertitude politique à un moment critique pour l’Europe. Récit proposé par Les Echos |
| DÉCARBONATION |
| Le secteur industriel appelé à maintenir le cap de la baisse des émissions carbonées En France, le secteur industriel représente approximativement 20 % des émissions de gaz à effet de serre, soit environ 78 millions de tonnes annuellement. Sylvie Padilla, de l’Agence de la transition écologique (Ademe), souligne l’importance cruciale de ce secteur dans l’atteinte de la neutralité carbone, conformément aux objectifs du pacte vert européen qui vise une réduction des émissions de 55 % d’ici 2030 par rapport à 1990, et le zéro carbone en 2050. Les émissions industrielles en France se concentrent principalement dans des zones telles que Dunkerque, l’axe Seine et Fos-sur-Mer. Pour adresser ce défi, l’État a initié en 2018 des contrats de transition écologique avec les principaux acteurs industriels, visant une décarbonation approfondie. Vincent Moulin Wright, de France Industrie, mentionne que ces contrats pourraient s’étendre à 170 sites, avec une focalisation sur l’électrification des processus, l’utilisation d’hydrogène bas carbone, la biomasse pour la production de chaleur décarbonée, et la capture, le stockage et l’utilisation de carbone. Cependant, la trajectoire de ces engagements est jugée à risque, notamment en raison de la dépendance à des soutiens publics substantiels, sans lesquels le retour sur investissement reste incertain. L’État a promis un soutien financier pouvant atteindre 10 milliards d’euros, mais l’incertitude budgétaire actuelle rend cet engagement précaire. De plus, l’accès à une électricité décarbonée à un prix compétitif reste une préoccupation majeure pour les industriels, avec peu de visibilité à ce jour. Outre les grands industriels, les entreprises de taille intermédiaire (ETI) sont également engagées dans la décarbonation. Frédéric Coirier, du Mouvement des entreprises de taille intermédiaire, encourage ces entreprises à réaliser des diagnostics énergétiques et des bilans carbone pour identifier les meilleures opportunités de réduction des émissions. Des mesures simples comme l’amélioration de l’éclairage et de l’isolation peuvent apporter des bénéfices rapides. Malgré les défis, l’industrie française progresse vers la neutralité carbone. L’Ademe et France Industrie soulignent que la majorité des industriels perçoivent désormais la décarbonation non seulement comme une nécessité environnementale mais aussi comme un avantage compétitif. Toutefois, la complexification réglementaire et le besoin d’un soutien adapté aux ETI sont des enjeux qui requièrent une attention urgente pour maintenir cette dynamique positive. Observé par Les Echos |
| COP29 |
| À Bakou, la difficile question du financement de la transition climatique La COP29, qui s’ouvre à Bakou, Azerbaïdjan, se profile comme une conférence cruciale, centrée principalement sur les enjeux financiers de la lutte contre le changement climatique. Après la COP28, qualifiée de “COP des fossiles”, cette nouvelle rencontre internationale sous l’égide des Nations Unies vise à définir un nouveau cadre financier, le “new collective quantified goal” (NCQG), pour soutenir les pays en développement dans leur transition écologique. Initialement, l’accord de 2009 prévoyait que les nations industrialisées versent annuellement 100 milliards de dollars aux pays du Sud à partir de 2020, un objectif atteint avec deux ans de retard. Cette situation a érodé la confiance des pays bénéficiaires envers leurs homologues du Nord, accentuant l’urgence de renégocier les termes et les montants de cette aide financière. Les discussions préliminaires révèlent déjà des tensions autour de la définition même de la finance climatique et des montants nécessaires. Les estimations des besoins oscillent grandement, allant jusqu’à 2.400 milliards de dollars par an d’ici 2030 selon certains experts, sans consensus en vue. La complexité des instruments financiers disponibles – fonds privés, publics, dons, prêts à conditions favorables – ajoute à la confusion et aux débats. Un point particulièrement épineux concerne l’élargissement de la liste des contributeurs. Depuis 1992, aucune mise à jour significative n’a été faite pour inclure des économies montantes comme la Chine, qui, malgré leur croissance, contribuent de manière limitée et peu transparente à la finance climatique. L’Union européenne, entre autres, insiste sur la nécessité d’inclure ces nouveaux acteurs pour partager équitablement le fardeau financier. Les enjeux de cette COP ne se limitent pas à la finance. Les discussions s’annoncent cruciales aussi pour les engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre, avec le spectre d’un réchauffement climatique qui pourrait atteindre 3,1 °C d’ici à 2100 si les efforts actuels ne sont pas intensifiés. Les “contributions déterminées au niveau national” (NDC), qui détaillent les stratégies de décarbonation de chaque pays, seront au cœur des négociations. La COP29 est donc un rendez-vous décisif, non seulement pour solidifier le financement de la lutte contre le changement climatique, mais aussi pour maintenir l’ambition de limiter le réchauffement bien en dessous de 2 °C, voire à 1,5 °C, conformément à l’accord de Paris. Les résultats de cette conférence pourraient déterminer la trajectoire future de notre planète face aux défis climatiques imminents. Décrypté par Les Echos |