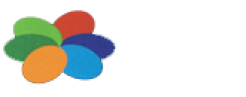| L’actualité de la semaine: |
| Le site spécialisé dédié aux acteurs de l’industrie pharmaceutique et cosmétique, pharmacos-media.fr, met cette semaine à l’honneur la denière innovation de la division Personal Care de BASF : Pepsensyal, un peptide synthétique novateur, conçu pour promouvoir un vieillissement cutané sain et retarder les manifestations visibles de l’âge. Toujours sur pharmacos-media.fr, nous est relayée l’information selon laquelle, à la faveur du congrès SEPAWA qui s’est tenu à Berlin en octobre dernier, BASF Care Chemicals a dévoilé sa nouvelle gamme Emulgade Verde, marquant une avancée significative dans l’industrie cosmétique grâce à l’intégration de principes de durabilité et de haute performance. Dans les colonnes du Figaro, alors que la France ouvre avec dix-huit mois de retard la concertation sur deux documents cruciaux pour son avenir énergétique et industriel, à savoir la Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC) et la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE), sont analysés les enjeux qui sous-tendent les débats. Le quotidien libéral L’Opinion rend compte du revirement de la France auprès des autorités bruxelloises : après avoir été l’un des fers de lance de l’engagement dans les ambitions environnementales, le ministre de l’Economie, Antoine Armand, plaide aujourd’hui plaide pour une révision des sanctions prévues en 2025 à l’encontre des constructeurs automobiles n’atteignant pas les objectifs intermédiaires de réduction des émissions carbonées. À la faveur de la COP16 sur la biodiversité qui s’est tenue à Cali, en Colombie, le Comité consultatif international sur les crédits biodiversité (IAPB) a présenté une feuille de route cruciale pour l’encadrement des crédits biodiversité que nous décryptent Les Echos. Enfin, Le Monde dresse un bilan très mitigé de cette 16e conférence des parties de la convention des Nations unies sur la biodiversité, laquelle s’est conclue brusquement, faute de quorum, laissant en suspens des questions cruciales telles que la mobilisation des ressources financières et l’évaluation des progrès. |
| Dans la presse cette semaine |
| PEPSENSYAL |
| La division Personal Care de BASF développe un nouveau peptide qui ralentit et assainit le vieillissement cutané La division Personal Care de BASF a récemment présenté Pepsensyal, un peptide synthétique novateur, conçu pour promouvoir un vieillissement cutané sain et retarder les manifestations visibles de l’âge. Cette innovation s’inspire des mécanismes naturels de régénération de la peau et s’aligne sur la demande croissante des consommateurs pour des soins préventifs, axés sur la santé et la longévité cutanée. Dans le contexte actuel, où la tendance du “vieillissement lent” gagne en popularité, les consommateurs recherchent des solutions pour maintenir une peau saine et équilibrée au fil du temps, plutôt que de recourir à des méthodes agressives pour combattre les signes de l’âge. Pepsensyal incarne cette philosophie en offrant un actif synthétique, basé sur un biopeptide humain, qui renforce et redensifie la peau. Son efficacité a été prouvée par un essai clinique randomisé impliquant 32 femmes âgées de 44 à 64 ans. Les résultats, après seulement 14 jours d’application, montrent une réduction notable des rides de la patte d’oie, une diminution de 11 % de la rugosité de la peau et une amélioration de 15 % de l’uniformité de son relief. En outre, des tests in vitro ont confirmé la capacité de Pepsensyal à revitaliser la peau en profondeur, renforçant ainsi son action anti-âge. Ce peptide se distingue également par sa composition à 99 % d’origine naturelle, sans conservateur et son caractère économique, offrant ainsi une solution efficace et accessible pour diverses formulations. Pepsensyal est une pièce maîtresse de la stratégie Care 360° de BASF, qui se concentre sur des solutions de soins durables et innovantes. En privilégiant la durabilité, l’innovation et l’établissement de nouvelles collaborations, BASF renforce sa position de leader dans le domaine des soins de la peau responsables et holistiques. Rapporté par pharmacos-media.fr |
| EMULGADE VERDE |
| Nouvelle innovation BASF Care Chemicals : une gamme d’émulsifiants biosourcés durable et performante À la faveur du congrès SEPAWA qui s’est tenu à Berlin en octobre dernier, BASF Care Chemicals a dévoilé sa nouvelle gamme Emulgade Verde, marquant une avancée significative dans l’industrie cosmétique grâce à l’intégration de principes de durabilité et de haute performance. Les émulsifiants Emulgade Verde 10 OL et Emulgade Verde 10 MS, conçus à partir d’ingrédients d’origine naturelle, illustrent l’engagement de BASF envers la chimie verte. Ils sont facilement biodégradables, non testés sur les animaux et certifiés par les labels Cosmos et Natrue, répondant ainsi aux exigences des formulations vegan. L’Emulgade Verde 10 OL, optimisé pour les procédés de fabrication à froid, offre une réduction significative des coûts, du temps de production et de la consommation énergétique, tout en restant polyvalent pour diverses applications telles que les sprays solaires. De son côté, l’Emulgade Verde 10 MS se distingue par sa solidité et sa flexibilité, adapté à une vaste gamme de produits, y compris les émollients, enrichissant ainsi les possibilités offertes aux développeurs de produits cosmétiques. La gamme a été rigoureusement testée pour sa tolérance cutanée, notamment sur des individus à la peau sensible, et les résultats ont confirmé son innocuité, sans réactions indésirables ni effets irritants ou comédogènes après quatre semaines d’application. Ces tests ont également démontré le respect du microbiome cutané par les produits. En somme, avec le lancement d’Emulgade Verde, BASF réaffirme son engagement pour un futur durable et élargit son offre d’ingrédients cosmétiques écoresponsables, consolidant ainsi sa position de leader dans la fourniture de solutions innovantes et respectueuses de l’environnement pour le secteur cosmétique. Relayé par pharmacos-media.fr |
| NEUTRALITÉ CARBONE |
| La France lance enfin la concertation sur la programmation pluriannuelle de l’énergie et la stratégie nationale bas carbone La France, avec un retard notable de 18 mois, a finalement initié la concertation sur deux documents cruciaux pour son avenir énergétique et industriel : la Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC) et la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE). Ces textes établissent respectivement la feuille de route pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre et définissent les politiques énergétiques pour la décennie à venir. Selon Olga Givernet, ministre déléguée à l’Énergie, ces orientations stratégiques, qui prévoient une réduction de 50% des émissions d’ici 2030 et la neutralité carbone en 2050, transcendent la durée de vie de l’actuel gouvernement, rendant la concertation indispensable pour leur réalisation. Dans ce cadre, la France se trouve confrontée à un défi de taille puisque 60% de sa consommation énergétique actuelle provient des énergies fossiles. La transition prévue est ambitieuse : réduire cette part à 29% d’ici 2035, tout en augmentant significativement la production d’électricité décarbonée. Le nucléaire, selon les plans, devrait retrouver sa capacité de production pré-crise d’EDF de 2022, avec une projection de 360 à 400 térawatt-heures pour 2030, incluant la mise en service de nouveaux réacteurs EPR. Parallèlement, comme le souligne Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition écologique, la France doit intensifier le développement des énergies renouvelables, un domaine où les objectifs précédents n’ont pas été atteints. Les nouvelles cibles envisagent un accroissement significatif des capacités en éolien et en photovoltaïque, ainsi qu’en production de chaleur renouvelable et de biogaz. Outre la production d’énergie, la sobriété et l’efficacité énergétique sont au cœur de la stratégie française. Le gouvernement envisage une réduction substantielle de la consommation énergétique d’ici 2035, avec des mesures rigoureuses dans le secteur du bâtiment, notamment une accélération des rénovations énergétiques. L’objectif est également de réduire considérablement l’usage des chaudières à fioul et à gaz dans les secteurs résidentiel et tertiaire. Les transports ne sont pas en reste, avec une stratégie visant à favoriser les modes de déplacement moins énergivores. L’objectif est de réduire de 31% les émissions de gaz à effet de serre du secteur d’ici 2030, en développant l’usage des transports en commun et en électrifiant les véhicules. Cependant, malgré ces plans ambitieux, le contexte budgétaire contraint et les retards accumulés posent des défis majeurs. La nécessité d’une stratégie financière efficace est impérative, comme le rappelle Agnès Pannier-Runacher, qui préconise une approche préventive plutôt que curative face aux défis climatiques. En somme, la France se trouve à un carrefour décisif, où la réussite de sa transition énergétique nécessitera une mobilisation sans précédent des acteurs publics et privés, ainsi qu’une gestion rigoureuse et innovante des ressources disponibles. Analysé par Le Figaro |
| PACTE VERT EUROPÉEN |
| La France plaide pour une révision des sanctions prévues en 2025 à l’encontre des constructeurs automobiles n’atteignant pas les objectifs intermédiaires de réduction des émissions carbonées La France, reconnue pour son engagement dans les ambitions environnementales à Bruxelles, notamment à travers le pacte vert européen, semble aujourd’hui à un tournant avec l’arrivée du nouveau gouvernement. Le ministre de l’Économie, Antoine Armand, a récemment exprimé le désir de réviser les amendes imposées aux constructeurs automobiles qui ne parviendraient pas à vendre suffisamment de véhicules électriques d’ici 2025. Ces amendes représentent des sommes considérables, s’élevant à des milliards d’euros au niveau européen. Lors du Mondial de l’auto, Antoine Armand a souligné les efforts des groupes français et a évoqué l’impossibilité de les sanctionner, cherchant des flexibilités en coalition avec d’autres partenaires européens. Cette démarche a été qualifiée de “prématurée” par la Commission européenne, rappelant que les objectifs de 2025 avaient été fixés en 2019, laissant ainsi le temps aux industriels de s’adapter. Certains constructeurs, comme Stellantis, sont déjà en voie d’atteindre ces objectifs, contrairement à d’autres comme Renault. Ces objectifs pourraient également être atteints via des véhicules hybrides ou thermiques moins consommateurs. Par ailleurs, Armand souhaite modifier le règlement européen sur les normes extra-financières (CSRD), qui a été une initiative française lors de sa présidence de l’UE. Cette proposition a suscité des réactions, notamment celle de Michel Barnier qui a suggéré un moratoire sur la transposition du droit européen, une idée rapidement retirée face aux critiques. Ces positions marquent un potentiel recul de la France dans son engagement envers le pacte vert, malgré les promesses de maintien d’une politique écologique par le président Macron. Ce changement de cap intervient dans un contexte où d’autres pays, comme l’Allemagne et l’Italie, ont également manifesté des réticences face aux directives climatiques strictes. Les critiques, notamment de figures écologistes au Parlement européen, soulignent un affaiblissement de la position de la France en tant que leader environnemental, au moment où l’Europe semble réduire ses ambitions écologiques avec une montée de la droite et de l’extrême droite. Ce repositionnement pourrait être perçu comme une menace pour l’héritage des politiques environnementales des dernières années, malgré les assurances du gouvernement qui nie tout recul dans ses engagements. Issu de L’Opinion |
| CRÉDITS BIODIVERSITÉ |
| COP16 de Cali : la feuille de route très attendue du Comité consultatif international sur les crédits biodiversité À l’occasion de la COP16 sur la biodiversité tenue à Cali, en Colombie, le Comité consultatif international sur les crédits biodiversité (IAPB) a présenté une feuille de route cruciale pour l’encadrement des crédits biodiversité. Ces instruments financiers, similaires aux crédits carbone, visent à valoriser les actions de préservation de la nature en émettant des crédits vendus au secteur privé. L’objectif est de mobiliser des fonds significatifs pour la conservation de la biodiversité tout en évitant les écueils du greenwashing, un problème déjà rencontré avec les crédits carbone. L’IAPB, co-présidé par Sylvie Goulard et Dame Amelia Fawcett, a été créé en juin 2023 et regroupe une vingtaine d’experts internationaux. Leur mission est de définir des principes clairs pour garantir l’intégrité et l’efficacité de ces crédits, en tirant les leçons des défis rencontrés par les marchés du carbone. La compensation, sujet de controverse, est strictement réglementée par l’IAPB qui recommande que toute action compensatoire reste locale et concerne des écosystèmes similaires. Cette initiative s’inscrit dans un contexte plus large où la Commission européenne, sous l’impulsion d’Ursula von der Leyen, plaide pour la création de crédits nature. Parallèlement, des recherches sont menées en France pour développer des méthodologies robustes de mesure de la biodiversité, en collaboration avec des institutions scientifiques de renom. Cependant, l’IAPB souligne les défis spécifiques liés à la mesure de la biodiversité par rapport au CO2, refusant l’idée d’une unité de biodiversité standardisée. Les crédits ne devraient pas être échangés sur des marchés secondaires pour éviter la spéculation, et les projets doivent impliquer les communautés locales et produire des bénéfices vérifiables pour la nature. Cette stratégie ambitieuse nécessite une adoption et une adaptation par les gouvernements à leurs cadres nationaux, et l’IAPB a identifié plusieurs projets pilotes pour guider les réflexions futures. Malgré les défis, cette approche représente une avancée significative dans la mobilisation des ressources privées pour la préservation de la biodiversité, essentielle pour répondre aux engagements internationaux de financement de la conservation de la nature. Décrypté par Les Echos |
| COP16 |
| Le bilan très mitigé de la 16e conférence des parties des Nations unies sur la biodiversité La 16e conférence des parties de la convention des Nations unies sur la biodiversité (COP16), présidée par Susana Muhamad, ministre de l’Environnement de Colombie, s’est achevée dans une atmosphère de forte émotion, oscillant entre tensions et célébrations. Cette réunion, qualifiée de « COP de la mise en œuvre », visait à concrétiser les engagements précédemment pris par les États pour la protection de la nature. Cependant, elle s’est conclue brusquement, faute de quorum, laissant en suspens des questions cruciales telles que la mobilisation des ressources financières et l’évaluation des progrès. Au cours de cette conférence, qui s’est tenue à Cali, des avancées notables ont été réalisées, notamment l’adoption de décisions importantes concernant les aires marines, les ressources génétiques et les droits des peuples autochtones. Un moment marquant a été la création d’un groupe permanent pour les peuples autochtones au sein de la Convention sur la diversité biologique, soulignant l’importance de leur rôle dans la conservation de la biodiversité. Un autre succès significatif a été l’adoption du principe d’un mécanisme multilatéral pour le partage des bénéfices découlant du séquençage des ressources génétiques, avec la création du fonds Cali. Ce fonds devrait recevoir une partie des revenus des entreprises exploitant ces ressources, bien que la contribution des entreprises reste volontaire, ce qui a suscité des critiques quant à l’efficacité de cette mesure. La conférence a également mis en lumière les défis persistants en matière de financement de la biodiversité. Les discussions sur la création d’un nouveau fonds pour la biodiversité ont révélé de profondes divisions entre les pays développés et les pays en développement, ces derniers réclamant un accès plus équitable aux ressources financières. En dépit de ces avancées, la COP16 s’est terminée sur un sentiment d’inachevé, exacerbé par l’absence de progrès sur certains enjeux majeurs et la suspension des débats. Cette conclusion souligne les difficultés persistantes dans la mise en œuvre des engagements internationaux pour la biodiversité, malgré l’urgence de la crise écologique soulignée par Antonio Guterres, secrétaire général des Nations unies. La COP16 de Cali restera dans les mémoires comme un événement qui a réussi à mobiliser la population locale et à sensibiliser le public à l’importance de la biodiversité, mais aussi comme un rendez-vous qui a révélé les limites et les défis de la coopération internationale en matière d’environnement. Source : Le Monde |